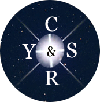 |
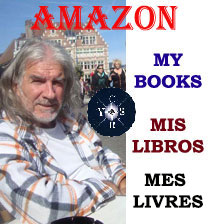 |
Amazon.com:LE CŒUR DE NOTRE-DAME MARIE DE NAZARETH:UNE HISTOIRE DIVINE |
LA PERSÉCUTION DE DIOCLÉTIEN ET LE TRIOMPHE DE L’ÉGLISE |
CHAPITRE DEUXIEME
L'ÉTABLISSEMENT DE LA TÉTRARCHIE ET LA PERSÉCUTION DANS L’ARMÉE(292-302).I
L’établissement de la tétrarchie.
Les deux Augustes n'étaient point parvenus à pacifier
l'Empire. Malgré la prudence politique de Dioclétien et l’énergie guerrière de
Maximien Hercule, toutes les frontières restaient menacées, tandis qu’au dedans
des ambitieux se soulevaient. Carausius tenait toujours la Bretagne; les Perses
s’avançaient à l’Orient; les Quinquegentans, que nous
avons déjà vus en mouvement sous Valérien, de nouveau s’agitaient aux confins
de la Numidie et de la Mauritanie. On dit qu’à la faveur de ces troubles un
usurpateur avait pris la pourpre en Afrique. La turbulente Égypte, qui allait,
elle aussi, se donner un empereur, remuait peut-être déjà. La Syrie venait
d’être pillée par les Sarrasins. Enfin, les peuples barbares, comme pris de
vertige, se heurtaient les uns contre les autres dans le vaste champ clos borné
par le Danube et le Rhin: agitation toujours périlleuse pour le monde romain,
dont les frontières s’ouvraient presque fatalement sous la pression des masses
germaniques. Inquiet, Dioclétien, après avoir longuement visité les provinces
danubiennes, donna, à la fin de 290 ou au commencement de 291, rendez-vous à
son collègue dans Milan. Il avait conçu un plan de réorganisation de l’Empire,
qui ne pouvait s’exécuter que par L’accord des deux Augustes.
Ce plan consistait á partager effectivement les contrées
soumises à la domination romaine. La division établie naguère entre Dioclétien
et Maximien Hercule l’avait été par la force des choses plutôt qu’en vertu
d’une convention formelle : Dioclétien s’était chargé de garder l’Orient,
Maximien de défendre l’Occident, comme, vingt-cinq années auparavant, Valérien
et Gallien, ou, plus récemment, Numérien et Carinus.
Aujourd’hui, c’était d’un partage véritable qu’il s’agissait. Cependant, même
partagé, l’Empire serait encore trop vaste. Si bon général qu’il fût, Hercule
ne pouvait être à la fois au nord et au midi, guerroyer tout ensemble contre les Francs et contre les Kabyles. Dioclétien, de son côté,
n’eût pu sans cesse passer et repasser les Dardanelles, pour courir au Danube
si les Goths remuaient, à l’Euphrate si c’étaient les Perses. Le plan de
Dioclétien se complétait donc en subordonnant à chacun des Augustes un César
investi pareillement d’un gouvernement territorial, mais cependant maintenu
dans la dépendance de l’Auguste, qui exercerait sur lui et sur ses États une
sorte de suzeraineté. Les deux empereurs, dont l’accord, depuis le commencement
de leur règne simultané, avait été inaltérable, convinrent aisément de ce
régime nouveau, et s’entendirent sur le choix des personnes. Si ces questions
furent agitées par eux, comme je le suppose, dans l’entrevue de Milan, ils
ajournèrent à une année la proclamation des Césars.
Un tel projet valait bien, en effet, qu’entre la résolution
et l’exécution on prit le temps de mûrir les détails et de prévoir les
conséquences. Ce n’était rien moins que la ruine de l’ancienne constitution.
L’innovation la plus grande ne consistait pas dans le partage des États : comme
les Césars devaient être inférieurs aux Augustes, et qu’entre ceux-ci mêmes il
existait une hiérarchie, Dioclétien demeurant incontestablement le premier,
l’unité romaine restait préservée dans son fond. Mais son symbole idéal et son
centre matériel allait être frappé de déchéance. Rome verrait d’autres
capitales, sièges d’une administration et d’une cour, usurper la réalité du
pouvoir, tandis qu’elle-même ne serait plus qu’une ombre antique et glorieuse.
Déjà Dioclétien, constructeur infatigable, avait fait de sa résidence
habituelle, Nicomédie, une rivale de la ville éternelle par la grandeur et la
beauté des édifices. Un coup plus sensible encore menaçait Rome. Dans la pensée
des réformateurs, les Césars tiendraient des seuls Augustes leur titre et leur
pourpre : le sénat ne serait appelé à intervenir ni dans le choix, ni même dans
sa ratification. Et comme les Césars, par l’adoption, devenaient chacun
l’héritier désigné de l’Auguste qui l’avait créé, le sénat n’aurait de rôle à
aucune époque dans la transmission de la puissance souveraine, habilement
soustraite à tous les hasards de l’élection, aussi bien au choix raisonné des
sénateurs qu’à l’acclamation tumultueuse des soldats. Ainsi le génie politique
de Dioclétien allait mettre fin à Tune des principales causes de faiblesse de
l’Empire, l’incertitude de la succession impériale; mais en même temps il
mettait fin à une des dernières majestés Romaines, celle du sénat : ce grand
corps ne serait tout à l’heure que le plus solennel et le plus aristocratique
des conseils municipaux, et Rome que la première des villes de province.
Si Dioclétien, au lieu de regarder encore l’Église
chrétienne d’un œil favorable, avait déjà nourri la secrète pensée d’une
persécution future, il se serait probablement aperçu d’une autre conséquence
des réformes projetées: la différence que le partage de la souveraineté
apportera, selon les lieux, dans l’exercice des édits qui pourront être rendus
pour cause de religion. Lors des grandes persécutions du troisième siècle, sous
Dèce ou sous Valérien, la guerre déclarée à l’Église par la puissance séculière
avait éclaté dans toutes les provinces à la fois: quelques différences
paraissaient dans la pratique, selon le tempérament des peuples ou le caractère
des magistrats; mais la volonté impériale était partout obéie, parce que les
provinces ne reconnaissaient toutes qu’un même maître. Au contraire, alors que,
sous Gallien, la souveraineté se trouva, de fait, quelque temps partagée, on
vit l’Église en paix dans les États soumis à l’autorité ou à l’influence de
l’empereur, et cependant persécutée dans les contrées où régnait le fanatique Macrien. Tout récemment encore, ne venait-elle pas de
souffrir en Occident sous Maximien Hercule, tandis qu’elle restait en repos
dans l’Orient sous Dioclétien? Plus grande encore sera l’incertitude de son
sort, quand il y aura quatre souverains, indépendants en fait malgré le lien théorique
de subordination qui existera entre eux, maîtres au moins d’aggraver ou de
tempérer dans leurs provinces les édits rendus pour l’universalité de l’Empire.
Le sort des chrétiens va donc dépendre, à l’avenir, du caractère des princes
dans le domaine desquels ils habiteront, et des intérêts particuliers de chacun
d’eux. On pourra voir une partie du monde romain désolée par la guerre
religieuse, une autre partie à peine touchée par elle; la persécution commencée
s’arrêtant ici après quelque temps, poursuivie là pendant de longues années.
Telle sera une suite inévitable des réformes de Dioclétien, sur laquelle
certainement sa pensée ne s’arrêta pas: mais une Providence miséricordieuse
semble l’avoir ménagée, afin que l’Église, dans les persécutions futures, ne
perdit pas tout son sang à la fois, et trouvât toujours quelque lieu où réparer
ses forces.
Le 1er mars 292, le dessein étudié par les deux Augustes
fut enfin mis á exécution. Maximien Galère et Constance Chloré furent élevés
l’un et l’autre à la dignité de Césars. On procéda ensuite à la répartition des
provinces entre les quatre souverains, ou plutôt on annonça cette répartition,
depuis longtemps convenue sans doute. Dioclétien se réserva l’Orient, avec
l’Égypte, la Libye, les îles et la Thrace; Galère, son César, eut les provinces
danubiennes, l’Illyrie, la Macédoine, la Grèce et la Crète; Maximien Hercule
conserva l’Italie, l’Afrique et, croyons-nous, l’Espagne; le César Constance
reçut la Gaule et la Bretagne, avec Hercule pour suzerain.
Les chrétiens mêlés alors à la politique, comme ces
gouverneurs et ces magistrats dont parle Eusèbe, purent sans doute prévoir les
résultats qu'aurait pour leur religion l'entrée des nouveaux membres dans le
collège impérial. Galère et Constance n'étaient pas des inconnus. Habiles
généraux, l'un et l'autre avaient été formés à la guerre sous Aurélien et
Probus. Pour tout le reste, rien ne différait plus que les deux Césars. Galère,
fils de paysan, lui-même, dit-on, ancien bouvier, gardait sous, la chlamyde de
l'officier supérieur comme sous la pourpre impériale la rusticité de son
origine. Son corps était d'un géant, ses manières rudes et hautaines, ses goûts
grossiers: l'histoire le montre cupide et crue; le sens droit et les talents
naturels qu'elle lui reconnaît restaient comme étouffés sous une honteuse
ignorance: non seulement il n'avait ni politesse ni lettres, mais il ne se
plaisait qu'avec ses semblables. Constance, Dace comme Galère, était de grande
famille, petit-neveu de Claude le Gothique. Sa santé toujours délicate,
remarquable à la pâleur de son visage, ne Pavait point-empêché de s'illustrer
par des victoires; mais les maux de la guerre, qu’il avait vus de près, lui
avaient donné de la compassion pour les misères des peuples. C’était une nature
fine, distinguée, bienfaisante, modérée dans ses goûts, un de ces vaillants qui
aiment la paix. Les sentiments religieux des deux princes étaient aussi peu
semblables que leur origine, leur caractère et leurs mœurs. Comme naguère
Aurélien, Galère gardait toutes les superstitions de son enfance : il les
tenait d’une mère aussi fanatique que la prêtresse de Sirmium, plus grossière
même dans sa religion, car, au lieu de Mithra, c’étaient les divinités de ses
montagnes qu’elle adorait par de fréquents sacrifices suivis d’interminables
festins. Cette paysanne, qui conserva une grande influence sur son fils devenu
empereur, lui avait inspiré, avec la passion de l’idolâtrie, une haine farouche
du christianisme. Constance, au contraire, était un de ces païens désabusés,
qui essayaient de concilier le culte national avec la morale et la raison, et,
méprisant les fables impures du polythéisme, élevaient leur cœur vers le Dieu
unique, père de tous les hommes. Cette religion naturelle suffisait aux
aspirations d'une âme à laquelle les incessantes occupations de la vie
militaire n’avaient guère laissé le temps de la méditation et de l’étude; mais
s’il se contentait de la doctrine des philosophes, Constance ne leur avait
emprunté aucun de leurs préjugés contre le christianisme : il se souvenait
peut-être qu’il comptait parmi ses ancêtres une chrétienne et une martyre;
peut-être aussi l’humble femme qui avait été la compagne de sa jeunesse, et que
l’impitoyable politique le contraignit de répudier pour devenir le gendre de
Maximien Hercule, lui avait fait respirer déjà le parfum des vertus chrétiennes
mêlé aux souvenirs ineffaçables d’un premier amour. Constance devait donc,
selon toutes les probabilités, être pour la paix religieuse un appui, et la maintenir
au moins dans ses États; les chrétiens prévoyants pouvaient, au contraire,
deviner en Galère un persécuteur. En apparence, rien n'était changé, à ce point
de vue, dans le collège impérial: l’intolérance païenne y avait toujours eu
pour champion Hercule, mais depuis longtemps la liberté des consciences y
comptait Dioclétien pour partisan convaincu : un César fanatique et un César
tolérant se joignaient à eux, sans altérer la balance des deux politiques. Mais
quiconque connaissait le caractère de Dioclétien, facile à intimider, celui de
Galère, entreprenant et audacieux, et songeait à l’ascendant qu’un tel homme
pouvait prendre sur un souverain déjà vieilli et fatigué, n'était point sans
quelque raison de craindre pour la durée de la paix religieuse.
A d'autres égards, cependant, l’association des quatre
empereurs produisit d'abord des résultats heureux. Les Maures défaits par
Hercule, Carausius vaincu par Constance, bientôt son successeur Alectus renversé; les Francs et les Alemans repoussés; les
Carpes soumis; les Marcomans défaits; Narsès, roi de Perse, battu par Galère,
et contraint de céder cinq provinces; l'Égypte rebelle domptée par Dioclétien :
tels furent, entre 292 et 300, les succès qui permirent aux souverains
d'ajouter de nouveaux titres à leur pompeuse nomenclature, et, chose plus
sérieuse, d'assurer la paix aux populations romaines. Ce temps si bien employé
pour les armes ne fut point stérile en réformes législatives. Le nombre des
lois promulguées par la tétrarchie, mais le plus souvent sorties du consistoire
de Dioclétien, est très considérable: plusieurs méritent l'attention, car elles
éclairent le caractère et les idées du prince. C'est ainsi qu'il publia en 295
un édit pour la réforme des mariages, trop souvent contractés au mépris des
empêchements posés par la nature ou la loi. Le ton, un peu emphatique, comme
dans tous les actes publics de cette époque, est cependant grave et religieux:
l'empereur déclare que «les dieux immortels ne continueront à favoriser le nom
romain, que si les princes obligent leurs sujets à mener une vie pieuse, morale
et paisible»; il proclame que «si la majesté de Rome est montée si haut, grâce
à la protection de tous les dieux, c'est parce que ses lois ont toujours été empreintes
d'une piété sage et d'une religieuse pudeur». Le sentiment parait sincère; on
reconnaît un souverain qui se fait une grande idée de ses devoirs; mais on
devine les extrémités où il se portera, si quelque influence parvient à lui
faire voir un jour dans les chrétiens des contempteurs de ces lois «religieuses
et chastes», des obstacles à la faveur divine, seul gage de la prospérité de
l’Empire.
J’attribue à cette époque le célèbre édit sur les manichéens,
dont la date est discutée. Il fut rédigé à Alexandrie, en réponse à une requête
du proconsul d'Afrique. Dioclétien alla deux fois à Alexandrie, d'abord en 290,
puis en 296, quand il vainquit la révolte d'Achillée. D'après quelques auteurs,
le superstitieux Auguste fit dans ce dernier voyage brûler des livres égyptiens,
consacrés à l’alchimie et aux sciences occultes. L’édit renferme également
cette barbare sanction. Il est dirigé contre les sectateurs de Manès, dont les
dangereuses doctrines avaient pénétré en Afrique, portées par un envoyé du
maître lui-même. L’empereur les condamne comme fauteurs d’une secte nouvelle,
et complices des Perses. «L’ancienne religion, dit-il, ne doit pas être
corrigée par une nouvelle, car c’est un très grand crime de retoucher à ce que
les anciens ont une fois défini, et qui a pris un cours certain et un état
fixe. C’est pourquoi nous avons une grande application à punir l’opiniâtreté
des méchants dont l’esprit est corrompu, et qui introduisent des sectes
nouvelles et inconnues pour exclure à leur fantaisie, par de nouvelles
religions, celles que les dieux nous ont accordées». Le crime est d’autant plus
impardonnable, que la secte vient d’un pays avec lequel Rome a des inimitiés
héréditaires. «Le nouveau prodige récemment révélé au monde a pris naissance
dans la nation persane, notre ennemie. De là sont sortis beaucoup de crimes;
les peuples ont été troublés, les cités en péril; il est à craindre que, dans
la suite, les sectaires ne s’efforcent de corrompre par les exécrables mœurs et
les infâmes lois des Perses des hommes innocents, le modeste et tranquille
peuple romain, et de répandre le poison dans le monde entier». Ces paroles font
probablement allusion aux lois immorales qui régnaient, dit-on, dans la Perse,
et plus encore à l’immoralité particulière des rites manichéens. On reprochait
aussi aux disciples de Manès de pratiquer la magie et de se livrer à tous les genres des maléfices»; le titre de
l'édit, tel qu'il nous est parvenu, semble montrer que, pour les Romains,
manichéen et magicien étaient synonymes. La sanction est terrible: les chefs de
la secte seront brûlés «avec leurs abominables écrits»; les adhérents qui
persévéreront auront leurs biens confisqués et subiront la peine capital; les
personnages de rang élevé, «qui se sont donnés à cette secte inouïe, honteuse,
entièrement infâme, ou à la doctrine des Perses», perdront également leur
patrimoine et seront envoyés aux mines. Ces rigueurs paraissent, cependant,
avoir été peu appliquées: en tous cas, elles n arrêtèrent point les progrès du
manichéisme. Mais, écrit à une époque où Dioclétien n'aurait pas songé à
confondre la religion chrétienne, dont il connaissait l’ancienneté et honorait
l’innocence, avec «cette secte inouïe, ce monstre de doctrine», l’édit montre
quels seront les sentiments et les procédés de l'empereur quand on lui aura
dénoncé dans les chrétiens mêmes, sinon des alliés des Perses, du moins des ennemis
de l'Empire, et qu'on aura réveillé les vieilles calomnies qui leur imputaient,
à eux aussi, toute sorte de maléfices. Il annonce non seulement les cruels
traitements qui leur seront infligés, mais encore cette destruction de leurs
Écritures, par où, dans quelques années, commencera la persécution. A ce titre,
il était intéressant d'analyser l’édit contre les manichéens; nous voyons le
futur persécuteur se dessiner d’avance en Dioclétien, dans un temps où lui-même
ne songeait pas encore à le devenir, mais où plusieurs, déjà, y pensaient
autour de lui.
Les derniers mots de l'édit parlent du «siècle très
heureux» où règnent Dioclétien et ses collègues. Le peuple, cependant,
commençait à sentir le poids de l’établissement nouveau. À quatre empereurs il
fallait quatre armées; il fallait aussi quatre capitales, avec tous les
monuments que ce mot comporte: Dioclétien résidait à Nicomédie, Hercule à
Milan, Galère à Sirmium, Constance à Trêves. Dans ces capitales étaient
entretenus non seulement l'attirail de plus en plus compliqué des chancelleries
et des bureaux, mais encore de vraies cours, où paraissait la pompe d'une
étiquette empruntée à l’Orient, avec le luxe inouï dont Dioclétien avait fait
un instrument de règne. Les impôts nécessaires pour soutenir cette organisation
civile et militaire et le faste des demeures impériales, devenaient accablants.
La bourgeoisie des villes, que la loi rendait responsable de leur perception,
succombait à la tâche : déjà il fallait retenir de force dans ses fonctions le
curiale prêt à s'enfuir; bientôt on fera de la curie une peine, et au lieu de
la prison ou du bûcher on y condamnera les chrétiens. Même en Gaule, où la
modération personnelle de Constance allégeait, malgré Dioclétien, les charges
fiscales, l'agriculture périssait, les champs incultes s'étendaient. Lactance
nous a transmis les plaintes du peuple opprimé : c'est, dit-on, un adversaire;
mais les adversaires sont ordinairement clairvoyants. D'ailleurs, Dioclétien
lui-même confesse la misère où tombait l’Empire, quand il tente ce remède
désespéré, cet expédient inapplicable, et qui fît couler le sang, un édit de
maximum. Est-ce pour rendre plus facile la rentrée de l’impôt, assurer la
défense nationale, ou donner aux ressorts administratifs une souplesse et une
précision plus grandes, qu’il opéra, vers 297, une nouvelle distribution du
territoire non plus entre les empereurs, mais entre leurs agents, divisant
l’Empire en quatre grandes préfectures, chacune d’elles en plusieurs diocèses,
et chaque diocèse en nombreuses et petites provinces? Les historiens modernes
admirent généralement cette réforme : « Cette construction politique,
disent-ils, où les assises d’en haut pesaient de tout leur poids sur les
assises inférieures, semblait capable de résister aux assauts du dehors et de
comprimer les mouvements de l’intérieur». Mais peut-être les contemporains
étaient-ils portés plutôt à dire avec Lactance, qu’en «brisant ainsi les
provinces en un grand nombre de morceaux», Dioclétien multipliait
singulièrement les fonctionnaires, instituait une foule d'emplois nouveaux,
imposait à tous les cantons, presque è toutes les villes, l'entretien
d'officiers inconnus jusque-là, superposait pour la première fois un peuple
d'administrateurs au peuple des administrés, et par conséquent augmentait le
fardeau sous lequel gémissait l’Empire. Sa réforme, en effaçant les différences
locales, en supprimant les privilèges, en faisant des nouvelles divisions administratives
l'équivalent de nos départements, diminua les franchises dont jouissait naguère
la vie provinciale et municipale, et qui avaient empêché les peuples de sentir
les entraves de la centralisation romaine. Celle-ci resserra son réseau
jusqu'alors large et flottant la
prochaine persécution va mettre le nouveau régime à l'épreuve, et montrer
comment, grâce à ses mailles étroites, auxquelles nul ne peut plus échapper, il
est un merveilleux instrument d'exaction et de tyrannie.
II
La persécution dans l’armée.
Les chrétiens étaient nombreux dans les armées des quatre
empereurs. Non seulement Dioclétien et Constance, favorables à leur religion,
mais Hercule et Galère acceptaient leur présence, sans exiger d’eux aucun acte
d'idolâtrie. L’affaire des Thébéens paraissait depuis
longtemps oubliée. De leur côté, les fidèles accordaient sans répugnance le
service militaire, et se dévouaient sincèrement aux aigles romaines.
En Afrique seulement, chez un petit nombre d’entre eux,
on aperçoit de l’hésitation à servir. L’esprit montaniste, fortifié par
l’entraînante éloquence de Tertullien, avait créé dans cette contrée un courant
d’idées excessives, contre lesquelles la prudence et le sens pratique des chefs
de l’Église eurent souvent à lutter. On se rappelle l’épisode qui donna lieu à
Tertullien d’écrire son traité De la couronne; et l’on sait que le
rigorisme du soldat célébré par l’apologiste ne fut point approuvé des autres
chrétiens. Dans le même traité, le dur et subtil Africain expose ses idées sur
la légitimité du service militaire! il distingue entre le soldat qui se fait
chrétien et le chrétien qui se fait soldat; au premier il montre quelque indulgence,
et lui permet à regret de persévérer dans son état; il blâme absolument le
second d’oublier que le Christ, en commandant à saint Pierre de remettre l’épée
au fourreau, a condamné le métier des armes, et en a fait «un acte illicite». «
Il n’y a pas, s’écrie-t-il ailleurs, de communauté possible entre les serments
faits à Dieu et les serments prêtés à l'homme, entre l’étendard du Christ et le
drapeau de Satan, entre le camp de la lumière et le camp des ténèbres; une
seule et même vie ne peut être due à deux maîtres, à Dieu et à César». On reconnaît
dans ces mots l'emphase habituelle à Tertullien, ce choc des antithèses qui
trop souvent chez lui remplace les raisons. Vainement, dans son admirable
Apologétique, avait-il rappelé la multitude des chrétiens qui servaient dans
les armées, et, réfutant par cet exemple les critiques des idolâtres, montré,
comme dit Bossuet, que «hors la religion tout le reste leur était commun avec
leurs concitoyens et les autres sujets de l’Empire»; ces paroles raisonnables
s'oubliaient vite, tandis que les esprits portés à l'exagération, si nombreux
sous l'ardent soleil d'Afrique qui tout à l’heure enfantera les donatistes, se
nourrissaient des hautaines affirmations et des éclatants paradoxes échappés la
plume de l’illustre écrivain. Un autre apologiste africain, Lactance, l’imitera
dans son rigorisme comme dans son grand style et son éloquence emportée: lui
aussi considérera les emplois qui obligent à verser le sang comme interdits à
un chrétien. Ces idées, exclues de l'enseignement des pasteurs et combattues
par la pratique universelle de l’Église, ne parvenaient point à dominer, malgré
les tendances outrées de l’esprit africain; cependant on les retrouvait dans
quelques familles. Elles y survivaient à l’hérésie montaniste, où elles avaient
pris naissance; de même que, chez nous, l’esprit du jansénisme survécut à ses
doctrines, et marqua longtemps de son empreinte de pieux fidèles auxquels
celles-ci auraient fait horreur.
En 295, sous le consulat de Tuscus et Anulinus, eut lieu en Afrique un tragique épisode,
où parait la prévention contre le métier des armes, particulière à certains
chrétiens de ce pays, et inconnue dans le reste de l’Église.
Bien que, au troisième siècle, les armées se recrutassent
surtout de volontaires, et que les levées de conscrits fussent rares, la loi
imposait aux enfants des vétérans, en compensation des privilèges accordés à
ceux-ci, l’obligation de servir. Cette hérédité du service personnel
entretenait dans les armées romaines l’esprit militaire, mais pouvait être,
pour quelques-uns de ceux qui y étaient soumis, la cause d’une véritable
oppression, en violentant leur vocation et leurs goûts. C’est ce que montre
l’histoire que nous allons raconter. Le 12 mars, on amena à Theveste (Tebessa) devant Dion Cassius, proconsul d’Afrique,
un vétéran, Fabius Victor, avec son fils Maximilien, agé de vingt et un ans. Bien que fils de soldat, Maximilien avait été élevé dans
les idées rigoristes, et croyait, comme Tertullien, la profession militaire
incompatible avec la pratique du christianisme. L'avocat du fisc, Pompeianus, prit la parole, et dit: «Fabius Victor est
présent avec le commissaire de César, Valerianus Quintianus; je requiers que Maximilien, fils de Victor,
conscrit bon pour le service, soit examiné et mesuré. — Quel est ton nom?» demanda
le proconsul au jeune homme. «Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Il ne m'est pas
permis d'être soldat, parce que je suis chrétien», répondit celui-ci, faisant
écho à l'une des plus rigoureuses sentences de Tertullien. «Approchez-le de la mesure»,
dit le proconsul. Maximilien répéta: «Je ne puis servir, je ne puis faire le
mal, car je suis chrétien». Pour lui encore, comme pour Tertullien, porter les
armes, c'était faire le mal: il considère, avec l’apologiste, «la plupart des
actes du service militaire comme des prévarications». Sans faire attention à
ses paroles, Dion renouvela l'ordre de le mesurer. Un des appariteurs déclara:
«Il a cinq pieds dix pouces». «Qu'on le marque», dit alors le proconsul. La marque
était double: on gravait sur la peau, au moyen d'un fer rouge, le nom de
l'empereur, imprimant ainsi un caractère indélébile à l'homme voué au service
militaire; puis on suspendait au cou du nouveau soldat une bulle de plomb avec
l'effigie impériale. A ces usages parait encore faire allusion Tertullien,
quand il dit: «Le chrétien se laissera-t-il brûler, selon la discipline du
camp, lui à qui il n'est pas permis de brûler, lui que le Christ a délivré de
la peine du feu?» et : «Demandera-t-il la livrée du pouvoir, lui qui a reçu
celle de Die» Se souvenant de ces paroles, Maximilien répondit une fois de plus:
«Je ne puis servir.»
Le proconsul n'était pas accoutumé à rencontrer une telle
résistance: «Sois soldat, dit-il, ou tu mourras.— Je ne serai pas soldat.
Coupe-moi la tête, si tu veux, mais je ne combattrai pas pour le siècle.— Qui
t’a inspiré de telles idées?—Mon cœur, et celui qui est l'auteur de ma vocation».
Dion, alors, se tournant vers le père: «Conseille ton fils. — Sa résolution est
prise, dit Victor, il sait ce qui lui convient». Le proconsul s’adressa encore
au jeune homme:
—Sois soldat, accepte la marque de l’empereur.
—Je ne reçois pas de marque, car je porte le signe du
Christ mon Dieu.
—Je vais t’envoyer tout de suite à ton Christ.
—Fais sans retard ; c’est ce que je souhaite : là est ma
gloire.
—Qu’on le marque, dit encore Dion.
Maximilien se débattit (3), en criant:
—Je ne reçois point de marque du siècle; si tu m’imposes
le signe de l’empereur, je le briserai, car pour moi il est sans valeur. Je
suis chrétien; il ne m'est pas permis de porter au cou la bulle de plomb, moi
qui porte déjà le signe sacré du Christ, fils du Dieu vivant, que tu ne connais
pas, du Christ qui a souffert pour notre salut, et que Dieu a livré à la mort
pour nos péchés. C’est lui que, nous tous chrétiens, nous servons; c’est lui
que nous suivons, car il est le prince de la vie, l’auteur du salut.
Dion insistait
toujours :
—Sois soldat, reçois les emblèmes militaires, afin de ne
pas périr misérablement.
—Je ne périrai pas; mon nom est déjà près de Dieu.
—Pense à ta jeunesse, consens à servir : cela convient à
un jeune homme.
—Ma milice est celle de Dieu ; je ne puis combattre pour
le siècle. Je l’ai déjà dit : je suis chrétien.
Le proconsul opposa vainement l’exemple de tant d’autres
fidèles :
—Mais, dit-il, dans la sacrée compagnie de nos seigneurs
Dioclétien et Maximien, Constance et Galère, servent des soldats chrétiens.
—Ils savent ce qui leur convient. Mais moi, je suis
chrétien, et ne puis servir.
—Ceux qui servent font-ils donc mal?
—Tu sais ce qu’ils font.
— Accepte de servir, de peur que ton mépris de la milice
ne soit puni de mort.
— Je ne mourrai pas; si je sors de ce monde, mon âme
vivra avec le Christ mon Seigneur.
Alors le proconsul fit effacer le nom du conscrit; puis,
se tournant vers celui-ci :
— Puisque, d’une âme insoumise, tu as méprisé le service,
tu encourras la sentence convenable, qui servira d’exemple.
Et il lut sur ses tablettes : «Maximilien, qui s’est
rendu coupable d’insoumission en refusant le service militaire, sera puni par
le glaive.»
Maximilien dit : « Grâces à Dieu! »
Conduit au lieu du supplice, il s’adressa aux autres
chrétiens : «Frères bien-aimés, de toutes vos forces, de tous vos désirs,
hâtez-vous afin d’obtenir la vue de Dieu et de mériter une semblable couronne.»
Puis, d’un visage riant, il pria son père de donner au bourreau le vêtement
neuf qui lui avait été préparé pour la milice, ajoutant : «Les fruits de cette
bonne œuvre se multiplieront au centuple; puissé-je te recevoir au ciel afin
d’y glorifier Dieu ensemble!» Il fut aussitôt décapité. Une matrone, nommée Pompeiana, obtint d’emporter son corps: le plaçant dans sa
litière, elle le conduisit à Carthage, où il fut enterré près de saint Cyprien.
Victor, plein de joie, rentra dans sa maison, remerciant Dieu de lui avoir
permis d’envoyer un tel présent au ciel.
La sincérité du jeune soldat, la grandeur de sa foi et de
son courage, ont mérité l’admiration de la postérité chrétienne. Mais on verra
difficilement dans son procès un acte de persécution. En ce moment même, comme
le lui avait rappelé le proconsul, beaucoup de ses coreligionnaires entouraient
les quatre empereurs, faisaient partie de leur cour ou de leur armée.
Maximilien n’est pas puni à cause de son culte; on n’essaie pas de lui faire
abjurer ses croyances ou de le contraindre à un sacrifice: on l’invite
seulement à imiter tant de ses frères qui servent dans les légions. La sentence
est prononcée non contre le chrétien, mais contre le réfractaire. Aussi n’entendons-nous
personne en dénoncer l’injustice, comme, dans une circonstance toute
différente, fera le greffier Cassien. Cependant, à y regarder de près, les
chrétiens auraient eu le droit de se plaindre, si leur foi n’avait mieux aimé
suivre dans son vol vers le ciel l’âme candide du jeune Maximilien. En le
condamnant à mort, le proconsul dépassait la mesure. La loi prononçait contre
les recrues insoumises un châtiment plus léger. «Ceux qui se refusaient au
recrutement, dit un jurisconsulte du commencement du troisième siècle, étaient
punis autrefois de la servitude, comme traîtres à la liberté; mais, les conditions
du service militaire ayant été changées, on ne prononce plus la peine capitale,
parce que les cadres des légions sont le plus souvent remplis par des volontaires».
Quand il fit tomber la tête du conscrit qui, mal renseigné tout ensemble sur les devoirs du chrétien et sur les obligations du soldat, mais
animé d'une ardente foi, avait si hardiment confessé Jésus, le proconsul semble
avoir cédé à un mouvement de haine religieuse. Il oublia cette maxime de
Fauteur cité plus haut: «On doit être indulgent pour le conscrit encore
ignorant de la discipline»; indulgence qu'un autre jurisconsulte étend même au
jeune soldat qui a déserté. Maximilien méritait d'être puni, mais n’aurait
probablement pas été mis à mort, s'il avait invoqué à l'appui de ses
répugnances une autre excuse que le titre de chrétien. Aussi n'a-t-il point
usurpé celui de martyr, sous lequel l’honore l’Église.
Quelque jugement, cependant, que nous portions sur la
sévérité du proconsul, cet épisode montre que, trois ans après l'établissement
de la tétrarchie, aucune mesure n’avait été prise contre les chrétiens de l’armée.
Des fidèles imbus d’idées rigoristes pouvaient apercevoir entre le service
militaire et leur religion une contrariété qui n’existait pas; mais les
empereurs pensaient encore autrement, et permettaient qu’autour d’eux on fût à
la fois soldat et chrétien. Un peu plus tard, cependant, éclata une persécution
contre les chrétiens de l’armée. Eusèbe en parle, en termes malheureusement
trop vagues: nous les rapporterons, et nous essaierons ensuite, à l’aide de son
propre témoignage ou d’autres documents, de retrouver les faits indiqués par
lui.
«Pendant que la situation des Églises était encore
intacte, dit-il, et que les fidèles gardaient la liberté de leurs réunions, la
justice divine se mit à nous frapper, insensiblement et avec modération, la
persécution commençant par ceux qui servaient dans les armées». Ce premier
avertissement, ajoute-t-il, ne fit pas cesser les désordres qui troublaient
alors les Églises. Cela montre que la persécution partielle et légère dont il
parle précéda de plusieurs années la persécution générale. Plus loin, il
revient sur le même sujet : «Il y eut des martyrs, non seulement quand la
persécution sévit contre tous les chrétiens, mais même longtemps auparavant,
quand la paix durait encore. Car alors le diable, qui a reçu la puissance sur
ce monde, commença de se réveiller comme d’un profond sommeil, et dressa contre
l’Église des embûches encore timides et dissimulées: il ne déclara pas la
guerre contre nous tous à la fois, mais attaqua ceux qui servaient dans l’armée:
car il croyait que les autres seraient abattus sans peine, s'il avait d’abord
vaincu ceux-ci : alors, dis-je, on put en voir un grand nombre qui, renonçant à
la milice, aimèrent mieux redescendre à la condition privée que d’abandonner le
culte du souverain maître de toutes choses.»
La persécution contre les soldats, distante, comme nous
l’avons dit, de la persécution générale, commencée par conséquent plusieurs
années avant 303, eut Galère pour auteur. «Longtemps avant les autres
empereurs, celui-ci s’efforça de détourner violemment de leur religion les
chrétiens qui servaient dans l’armée, et surtout ceux qui habitaient dans son
palais; il priva les uns de l’honneur de la milice, il accabla les autres de
toute sorte d’outrages: il en mit même quelques-uns à mort». On s’expliquerait difficilement
qu'un simple César ait eu l'audace de commencer à lui seul la persécution,
contrairement aux intentions bien connues de l'Auguste duquel il dépendait, si
l'on ne se souvenait de l'éclatante victoire qui, en 297, mettant le roi de
Perse aux pieds de Galère et gagnant à l’Empire cinq provinces, avait donné à
l'heureux guerrier un ascendant dont il ne cessera plus d’abuser. Peut-être,
dans sa première expédition vers la Mésopotamie, qui se termina par une défaite
aujourd’hui si glorieusement vengée, avait-il rencontré sur son chemin Hiéroclès, gouverneur de Palmyre, déjà préparant un livre
contre les chrétiens : le fanatisme du paysan dace se serait aiguisé aux haines
raffinées du néoplatonicien. Aujourd’hui qu’il lui est permis de tout oser, et
que lui-même se considère déjà comme l’égal de Dioclétien, Galère donne cours à
une rage longtemps comprimée. Le tribun André et ses compagnons sont immolés le
9 août dans les défilés de l’Anti-Taurus, après avoir pris une part active à la
défaite des Perses . Deux officiers d’une cohorte de Barbares auxiliaires,
Serge, primicier de la Schola gentilium, et
Bacchus, commandant en second de la même troupe, périssent le 7 octobre pour le
Christ dans la Célé-Syrie. Deux magistrats municipaux, Hipparque et Philothée, sont mis à mort le 9 décembre avec trois de
leurs concitoyens, à Samosate, parce qu'ils s’étaient abstenus de paraître à un
sacrifice d'actions de grâces offert par l'empereur. Les lieux assignés au
martyre de ces saints se trouvent sur le passage d'une armée revenant lentement
d’Arménie par la Mésopotamie et la Syrie vers la mer Égée : c’est la route que
prit Galère, alors qu’après avoir séjourné près de Dioclétien à Nisibe, et
conclu la paix avec les Perses, il regagna ses États d'Europe.
Galère trouva un docile instrument de ses rigueurs contre
les soldats et surtout les officiers chrétiens. «Je ne sais quel chef de
l'armée romaine, dit Eusèbe, entreprit de les poursuivre : il commença d’inspecter
les chrétiens de l'armée, leur laissant le choix de conserver leurs honneurs et
leurs grades, en obéissant aux ordres impériaux, ou, s’ils refusaient, d’être
exclus de la milice». C'était, pour les officiers, la dégradation (gradus dejectio); pour les soldats, le renvoi ignominieux (ignominiosa missio),
avec privation du titre et des privilèges des vétérans. «Beaucoup de ces
champions du Christ préférèrent sans hésiter la confession de son nom à la
gloire et aux avantages du monde. Un petit nombre d’entre eux perdirent pour la
défense de la piété non seulement leur dignité, mais encore leur vie, à une
époque où celui qui tendait des pièges à notre religion n’osait encore verser
le sang que rarement et avec précaution». La Chronique d’Eusèbe, plus explicite
que son Histoire, donne un nom, qui doit être celui du général dont il est
question plus haut : «Veturius, maître de la milice,
poursuit les soldats chrétiens, et depuis ce temps la persécution commence peu
à peu contre nous». Il s’agit ici d’une véritable épuration de l’armée, au
moins pour les États de Galère, car le maître de la milice était un commandant
supérieur, une sorte de ministre de la guerre, occupant dans la hiérarchie
militaire un rang analogue à celui du préfet du prétoire dans la hiérarchie
civile. L’opération confiée à Veturius se place entre
la quatorzième et la dix-septième année de Dioclétien, c’est-à-dire entre 298
et 301. Ce fut probablement la suite, plus régulière et plus méthodique, des
premières violences exercées par Galère pendant sa campagne d’Orient.
La persécution dut sévir particulièrement dans les
provinces où les légions étaient campées. C’est ainsi que la Mésie, siège d’une
des plus grandes agglomérations militaires de l’Empire romain, vit périr plusieurs
soldats, par l’ordre du gouverneur Maxime. On cite, à Dorostore,
deux martyrs, appartenant probablement à l’armée, Pasicrate et Valention. Le vétéran Jules, qui avait refusé de
recevoir une gratification à l’occasion de quelque fête militaire ou impériale
dans laquelle des actes d’idolâtrie étaient maintenant exigés, fut traduit
devant Maxime par les officiales chargés de la
recherche des délinquants. Les Actes de son procès ont été conservés, et
méritent d'être intégralement traduits.
—Jules, demanda le président, qu’as-tu à répondre? ce
qu’on rapporte de toi est-il vrai?
—Je suis chrétien. Je ne puis me dire autre que je ne
suis.
—Quoi donc? ignores-tu que les princes ont donné l’ordre
de sacrifier aux dieux?
—Je ne l’ignore pas, mais, étant chrétien, je ne puis
faire ce que vous voulez et renier le Dieu vrai et vivant.
—Quel mal y a-t-il donc à offrir de l'encens et à s’en
aller?
—Je ne puis transgresser les préceptes divins et obéir
aux infidèles. Dans votre frivole milice, où j’ai servi pendant vingt-six ans,
je n’ai jamais été poursuivi pour crime ou délit. Sept fois j'ai pris part à la
guerre; je n’ai point désobéi À mes chefs, ni combattu moins bien qu'aucun
autre. Jamais le prince ne m’a trouvé en défaut : crois-tu donc qu’après avoir
rempli fidèlement des devoirs inférieurs, je paraîtrai aujourd’hui infidèle à
des obligations plus hautes?
—Dans quel corps as-tu servi?
—J’ai porté les armes, je suis sorti à mon tour, mais je
suis toujours vétéran. Cependant j’ai adoré le Dieu vivant, qui a fait le ciel
et la terre; aujourd’hui, je ne me montrerai pas moins fidèle serviteur.
—Jules, je vois que tu es un homme grave et sage.
Laisse-toi persuader et sacrifie aux dieux.
—Je ne ferai pas ce que tu demandes, et je n’encourrai
pas par un péché un châtiment éternel.
—Je prends le péché sur moi. Je te fais violence, afin
que tu ne paraisses pas acquiescer de ton plein gré. Ensuite tu pourras rentrer
en paix dans ta maison. Tu recevras la gratification de dix denier, et personne
ne t’inquiétera.
On reconnaît dans ce langage la répugnance de certains
magistrats pour les cruels offices dont ils étaient chargés, et leur désir
d'accepter les plus légères marques de soumission extérieure; nous verrons
d'autres exemples de ces dispositions quand la persécution générale aura
commencé. Cependant Jules refusa de se laisser séduire:
—Ni cet argent de Satan, ni tes paroles captieuses, ne me
feront perdre le Dieu éternel. Je ne le puis renier. Condamne-moi donc comme
chrétien.
—Si tu n'obéis pas aux ordres royaux, si tu ne sacrifies
pas, je te ferai décapiter.
—Tu feras bien. Je te conjure donc, pieux président,
accomplis ton dessein, et condamne-moi: mes désirs seront satisfaits.
— Ils le seront, en effet, si tu ne veux pas te repentir
et sacrifier.
— Grâces te soient rendues, si tu agis ainsi.
— Tu as bien hâte de mourir : tu crois donc en tirer
quelque gloire?
— Si je mérite de souffrir, j’acquerrai une gloire éternelle.
— Si tu souffrais pour la patrie et pour les lois, tu
acquerrais vraiment une telle gloire.
— Je souffre pour les lois, mais pour les lois
éternelles.
— Ces lois vous ont été données par un homme qui mourut
crucifié. Vois ta folie, de préférer un homme mort à nos princes vivants!
— Il est mort pour nos péchés, afin de nous donner la vie
éternelle. Dieu vit éternellement; celui qui le confesse aura la vie éternelle;
mais une peine éternelle attend celui qui l’aura renié.
— J’ai pitié de toi; je te conjure de sacrifier plutôt,
afin de vivre avec nous.
—Vivre avec vous serait pour moi la mort; mais si je
meurs, je vivrai.
— Écoute-moi, et sacrifie; sinon, je tiendrai ma promesse
et te ferai périr.
— J’ai souvent demandé de mériter un tel sort.
— Tu as donc choisi de mourir?
— J’ai choisi une mort temporaire, mais une vie
éternelle.
Maxime prononça la sentence :
—Que Jules, qui n’a pas voulu obéir aux princes, encoure
la peine capitale.
On le conduisît au lieu du supplice. Les fidèles, qui
n’étaient point alors inquiétés, l’entouraient en foule et l’embrassaient. «
Que chacun voie dans quel esprit il me baise» dit le martyr, voulant sans doute
avertir ceux que la compassion attirait vers lui plutôt qu’une sainte
allégresse. Un soldat chrétien, Hésychius, alors
prisonnier, se trouvait présent : peut-être avait-il été amené pour que le
procès ou l’exécution d’un coreligionnaire lui fit abandonner la foi. Mais,
loin d’être ébranlé, Hésychius, s’adressant au saint
: «Je t’en prie, Jules, poursuis joyeusement ce que .tu as commencé, et obtiens
la couronne promise par le Seigneur à ceux qui le confesseront. Souviens-toi de
moi, car je vais te suivre. Salue aussi les serviteurs de Dieu Pasicrate et Valention, qui par
une bonne confession nous ont précédés vers le Seigneur.» Jules, embrassant Hésychius : «Frère, dit-il, hâte-toi de venir. Car ceux que
tu as salués ont déjà entendu tes recommandations». Tout en parlant, le vétéran
avait couvert ses yeux avec un linge, noué autour de la tête; puis, tendant le cou,
il dit : «Seigneur Jésus, pour le nom de qui je souffre, daigne placer mon âme
parmi tes saints». Le bourreau tira le glaive : Jules fut décapité le 27 mai. Hésychius périt quelques jours après.
La Mésie vit d'autres scènes de persécution. La recherche
des soldats chrétiens, confiée dans cette province au gouverneur Maxime, amena
la comparution de deux militaires, Nicandre et Marciten,
dont le procès est plus émouvant encore, car, usant de la faculté accordée
depuis Septime Sévère aux soldats, tous deux étaient mariés. Ils paraissent
avoir été récemment convertis. Comme tant d’autres dont parle Eusèbe, «ils
abandonnèrent la gloire de ce monde pour la milice céleste», c’est-à-dire que,
mis en demeure de renoncer à leurs grades ou à leur religion, ils préférèrent
celle-ci à ceux-là. Cependant, par une sévérité exceptionnelle du juge, ou
plutôt par une faveur spéciale de la Providence, ils furent au nombre des
militaires dont parle encore Eusèbe, qui «perdirent pour la défense de la piété
non seulement leur dignité, mais encore leur vie».
—Si vous n’ignorez pas, leur dit Maxime, les ordres des
empereurs, qui vous commandent de sacrifier aux dieux, approchez, Nicandre et
Marcien, et faites acte d’obéissance.
—Ces ordres, répondit Nicandre, sont pour ceux qui
veulent rester dans la milice; mais nous, qui sommes chrétiens, nous ne pouvons
être tenus d’y obéir.
—Pourquoi, reprit Maxime, ne recevez-vous pas la solde de
votre grade?
— Parce que l’argent des impies souille les hommes qui
veulent servir Dieu.
Maxime insista :
—Avec un peu d’encens, Nicandre, honore les dieux.
—Comment un chrétien pourrait-il adorer des pierres et du
bois, au mépris du Dieu immortel qui nous a tirés du néant et qui conserve tous
ceux qui espèrent en lui?
Daria, l’épouse de Nicandre, était présente:
—O mon seigneur, dit-elle, prends garde de ne point faire
ce qu’on te commande; prends garde de ne point renier Notre-Seigneur
Jésus-Christ. Lève tes yeux vers le ciel, tu y verras Celui pour qui tu dois
conserver ta foi et ta conscience. C'est lui qui sera ton secours.»
Avec ce mépris
brutal de la femme, que professaient tant de païens, Maxime ne comprit point le
sentiment tendre, délicat et fier dont Daria était animée; se trompant sur ses intentions:
—Mauvaise tète de femme, cria-t-il, pourquoi désires-tu
la mort de ton mari?
—Pour qu’il vive avec Dieu, répondit-elle intrépidement,
et pour qu’il ne meure jamais.
—Ce n’est pas cela, répartit Maxime, mais tu désires
t’unir à quelque mari plus robuste; voilà pourquoi tu excites celui-ci à courir
vite à la mort.
A ces mots, Daria se dressa dans sa dignité outragée
d’épouse et de chrétienne :
—Puisque tu me soupçonnes d’avoir de telles pensées et
d’être capable d’une telle conduite, fais-moi mourir la première pour le
Christ, si tu as aussi des ordres concernant les femmes.
Mais la persécution ne regardait encore que les soldats;
Maxime répondit :
—Nous n’avons aucun ordre concernant les femmes; aussi ne
ferai-je point ce que tu demandes : cependant tu iras en prison.
Quand elle y eut été conduite, Maxime essaya encore de
persuader Nicandre.
—N’écoute pas, lui dit-il, les paroles de ton épouse, ou
des conseils semblables aux siens, de peur d’être promptement privé de la
lumière; mais, si tu le veux bien, accepte un délai, pour examiner en toi-même
s’il vaut mieux vivre ou mourir.
—Le délai que tu m’offres, répondit le soldat, suppose
qu’il est déjà passé: l’examen est fait, et je suis résolu à désirer avant tout
d’être sauvé.
—Dieu soit remercié!, dit à demi-voix le
gouverneur.
—Oui, Dieu soit remercié, répéta Nicandre.
Cette même acclamation, prononcée à la fois par le juge
païen et par le martyr, montre que les formules chrétiennes avaient fini par
pénétrer dans le langage couant, et que le paganisme
lui-même, tout en persécutant au nom des dieux, était travaillé par l’idée
monothéiste. Cependant Maxime s’était mépris sur la pensée du soldat. Il avait
compris que Nicandre cédait par amour de la vie, et, plein de joie, il se félicitait
déjà avec son assesseur Leucon : nous avons déjà vu,
par les Actes de saint Jules, que Maxime répugnait à verser le sang. Mais
Nicandre n’avait voulu parler que du salut éternel. On l'entendit prier Dieu
tout haut, le remerciant, lui demandant d'être délivré des tentations de cette
vie.
—Comment, s’écria le juge, toi qui tout à l’heure m’as
déclaré que tu voulais vivre, voilà que de nouveau tu désires mourir!
— Je veux vivre, répondit Nicandre, mais de la vie
éternelle, non de la vie passagère de ce monde: aussi je te rends maître de mon
corps. Fais ce que tu veux : je suis chrétien.
Pour la première fois, le gouverneur se tourna vers
Marcien :
—Et toi, Marcien?, dit-il.
Celui-ci répondit :
—Ce que déclare mon camarade, je le déclare aussi.
—Alors, prononça le président, vous serez tous deux mis
en prison, et bientôt sans doute vous subirez votre peine.
Maxime, cependant, ne se hâta point : un long délai fut
accordé aux deux soldats. Après vingt jours passés en prison, ils furent de
nouveau conduits au gouverneur:
—Nicandre et Marcien, leur dit-il, vous avez eu le temps
de vous décider à obéir aux ordres impériaux.
Ce fut Marcien qui répondit :
—La multitude de tes paroles ne pourra nous faire
abandonner la foi et renier Dieu. Il est présent à nos yeux, et nous savons où
il nous appelle. Aujourd’hui est consommée notre foi au Chris : renvoie-nous
promptement, afin que nous voyions le Crucifié, celui que vous ne craignez pas
de blasphémer, et que nous vénérons et adorons.
—Selon votre désir, dit Maxime, vous serez livrés à la
mort.
—Par le salut des empereurs, reprit Marcien, fais vite,
nous t’en supplions, non par crainte des supplices, mais afin de jouir plus tôt
de notre désir.
—Ce n’est pas à moi que vous résistez, répondit le juge,
et ce n’est pas moi qui vous poursuis: je suis donc étranger à votre sort, et
pur de votre sang. Si vous croyez que votre course sera bonne, je vous félicite
: que votre désir s’accomplisse!
Et il prononça la
sentence capitale. «La paix soit avec toi, président humain!» s’écrièrent
ensemble les condamnés.
Joyeux et bénissant Dieu, ils allèrent au supplice. La
femme de Nicandre, délivrée de prison, accompagnait son mari: son petit enfant
était avec elle, porté par Papien, frère du martyr Pasicrate. Près de Marcien marchait également la femme de
celui-ci, accompagnée de ses parents; mais elle était païenne, et se lamentait
en déchirant ses vêtements.
—Voilà bien, ô Marcien, s’écriait-elle, ce que je te
disais dans la prison, voilà ce que je craignais, ce que je pleurais d’avance.
Malheureuse que je suis! tu ne me réponds pas. Aie pitié de moi, ô mon seigneur
: regarde ton très doux enfant: retourne-toi vers nous, ne nous méprise pas. Où
te hàtes-tu? où veux-tu aller? pourquoi nous hais-tu?
tu te laisses traîner comme une brebis au sacrifice.
Marcien la regarda
sévèrement:
—Jusques à quand, dit-il, Satan aveuglera-t-il ton esprit
et ton cœur? éloigne-toi de nous: laisse-moi achever pour Dieu mon martyre.
Un chrétien, nommé Zotique, prît la main du courageux
soldat :
—Aie courage, mon seigneur et mon frère. Tu as combattu
le bon combat: d’où vient qu’à nous, si faibles, est accordée une telle foi?
Souviens-toi des promesses que le Seigneur a daigné faire, et qui pour vous
vont s’accomplir. Vous êtes vraiment les chrétiens parfaits et les bienheureux.
L’épouse de Marcien, cependant, s’approchait tout en
larmes, et tâchait de le tirer en arrière. Alors Marcien à Zotique :
—Retiens-la; et Zotique, abandonnant la main du martyr,
retint la malheureuse femme. Mais, quand on fut arrivé au lieu de l’exécution,
Marcien porta les yeux tout autour de lui: apercevant Zotique, il l’appela, et
le pria de lui amener celle qu’il avait écartée par vertu, mais qu’il aimait
toujours. Quand elle fut près de lui, il l’embrassa, en disant:
—Retire-toi maintenant dans le Seigneur. Car tu ne
pourrais me regarder célébrant mon martyre, pendant que ton âme est encore au
pouvoir du malin.
Il embrassa ensuite son enfant, et, levant les yeux au
ciel, dit :
—Seigneur Dieu tout-puissant, prends-le sous ta garde.
Puis Marcien et Nicandre se donnèrent à leur tour le
baiser de paix. Au moment où ils se séparaient pour s’agenouiller devant
l’exécuteur, Marcien aperçut l’épouse chrétienne de Nicandre, qui essayait
vainement de percer la foule pour approcher de son mari. Toujours calme et
maître de lui-même, il tendit la main à la jeune femme et la conduisit à. celui
qu’elle cherchait. «Dieu soit avec toi» dit simplement Nicandre. Mais elle : «Mon
bon seigneur, aie bon courage. Montre-toi vaillant dans le combat. J’ai passé
dix années dans mon pays, séparée de toi, et à tous moments attendant de Dieu
la joie de te revoir; maintenant je t’ai vu, et je te félicite de quitter cette
vie. Voici que je vais être élevée et glorifiée, devenant l’épouse d’un martyr.
Aie bon courage, mon seigneur, rends ton témoignage à Dieu, afin de me délivrer
aussi de la mort éternelle.» Le bourreau s'approcha, banda les yeux des
martyrs, et leur donna le coup mortel. C’était le 17 juin .
Les passages d’Eusèbe relatifs à la persécution des
soldats parlent d'abord de l'Orient, puis des États de Galère ; mais il est peu
douteux qu'Hercule ait suivi avec empressement l'exemple donné par le tout-puissant
César, et fait aussi dans ses armées la recherche des militaires chrétiens. A
cette période, antérieure de quelques années à la grande persécution, me paraissent
pouvoir être attribuées les exécutions de soldats que marquent, à Rome ou en Italie,
quelques documents hagiographiques. Aucun, malheureusement, ne vaut les deux
belles Passions qui viennent d'être résumées; mais on en peut tirer cependant
des faits vraisemblables. Un récit, maladroitement rattaché à celui d'un
martyre de quelques années postérieur, nous fait connaître la mort pour le
Christ de quatre adjudants appartenant probablement à la garde impériale (equites singulares):
ils furent exécutés dans Rome même, devant le temple d’Esculape, dans le
voisinage des thermes de Trajan; leurs corps, recueillis par saint Sébastien,
furent enterrés à trois milles de la cité, sur la voie Labicane.
La mort de saint Sébastien lui-même, qui commandait une des cohortes
prétoriennes, me semble aussi appartenir à cette époque plus vraisemblablement
qu'à aucune autre. Quatre martyrs enterrés dans la catacombe d’Albano, fondée
d’abord pour les soldats chrétiens de la légion II Parhica,
peuvent avoir fait partie de cette légion, et être tombés victimes de la
persécution dirigée à la fin du troisième siècle contre les fidèles de l’armée.
Peut-être doit-on rapporter encore au temps de la rigoureuse et parfois
sanglante épuration militaire, commencée dans les provinces de Galère et
poursuivie dans celles d'Hercule, plusieurs martyrs d'Italie dont le souvenir a
été mêlé sans preuves à celui de la légion Thébéenne.
L’intolérance d’Hercule et de Galère parut non seulement
par la recherche directe des soldats chrétiens, mais encore par l’obligation
imposée à tous les militaires de prendre part, les jours de fête, aux
cérémonies religieuses célébrées dans les camps. Naguère on fermait les yeux
sur leur abstention : maintenant celle-ci ne leur est plus permise, on les «pousse
de force» aux festins et aux sacrifices. C’était un moyen sûr d’éprouver les
chrétiens qui restaient encore dans l’armée. Le centurion Marcel souffrit le
martyre pour s'être indigné contre cette forme hypocrite d'oppression des
consciences.
On célébrait à Tanger l’anniversaire de la naissance de
Maximien Hercule. Tous les soldats assistaient aux sacrifices et aux repas qui
les accompagnaient. Marcel, centurion de la légion Trajane, s'approcha des
drapeaux, qu'on avait formés en trophée pour recevoir l’encens et les adorations:
il jeta devant eux sa ceinture militaire, en s’écriant : «Je suis soldat de
Jésus-Christ, le roi éternel». Il rejeta aussi le cep de vigne, insigne de son
grade, et ses armes, ajoutant : «A partir de ce jour, je cesse de servir vos
empereurs, car je ne veux pas adorer vos dieux de bois et de pierre, sourdes et
muettes idoles. Si telle est la condition des militaires, qu’ils soient
contraints d’offrir des sacrifices aux dieux et aux empereurs, je jette le cep
et le ceinturon, je renonce aux drapeaux, et je refuse de servir». Le motif de
la désertion ne pouvait être plus clairement expliqué; Marcel renonce au
service militaire, parce qu’on ne peut plus être soldat sans être contraint à
des actes d'idolâtrie. A ses paroles, tous les assistants restèrent frappés de
stupeur; puis ils le saisirent, et le conduisirent au préfet légionnaire,
Anastase Fortunat, qui le fit mettre en prison. Quand les fêtes eurent pris fin,
celui-ci fit amener le centurion Marcel.
—Pour quel motif, demanda-t-il, as-tu rejeté la ceinture,
le baudrier et le cep, contrairement à la discipline militaire?
— Le 12 des calendes d’août, répondit Marcel, en présence
des enseignes de la légion, pendant que vous célébriez la fête de l’empereur,
j’ai dît à haute voix que j’étais chrétien, et ne pouvais servir que
Jésus-Christ, fils du Dieu tout-puissant.
—Je ne puis, dit Fortunat, passer sous silence ta témérité;
j’en ferai rapport aux empereurs et au César. Je ne t’infligerai aucune peine,
mais je vais te faire conduire à mon seigneur Aurelius Agricolanus, vicaire des
préfets du prétoire»
Soit pour laisser à Marcel le temps de se repentir, soit
parce qu'on attendait la réponse impériale, sa comparution devant le vicaire
fut longtemps différée. Elle n’eut lieu que le 30 octobre. Le procès-verbal a
été conservé; en voici la traduction:
—Le trois des calendes de novembre, le centurion Marcel
ayant été présenté à Tanger, de l’officium on
dit : «Le préfet Fortunat a renvoyé devant ta puissance Marcel, un des
centurions. Voici le rapport qu’il t’adresse; si tu l’ordonnes, je le lirai.»
Agricolanus dit: «Qu’on le lise.» De l’officium on lut: «A toi, seigneur, Fortunat, etc. Ce soldat, ayant rejeté le ceinturon
militaire, s’est déclaré chrétien, et a proféré de nombreux blasphèmes contre
César. C’est pourquoi nous te l’avons adressé, afin que ce que Ta Clarté aura
décidé de lui, tu ordonnes de l’observer». Cette lettre ayant été lue,
Agricolanus dit : «As-tu prononcé les paroles relatées dans le rapport du
préfet?» Marcel répondit: «Je les ai prononcées». Agricolanus dit: «Tu servais
comme centurion ordinaire?» Marcel répondit : « Je servais» Agricolanus dit: «Quelle
fureur t’a fait renoncer au serment militaire et parler de la sorte?» Marcel répondit
: « Il n’y a point de fureur en ceux qui craignent Dieu» Agricolanus dit : «As-tu
prononcé toutes les paroles qui sont contenues dans le rapport du préfet?»
Marcel répondit: «Je les ai prononcées» Agricolanus dit: «As-tu jeté tes armes?»
Marcel répondit: «Je les ai jetées. Car il ne convenait pas qu’un chrétien qui
sert le Seigneur Christ servit dans les milices du siècle» Agricolanus dit: «La
conduite de Marcel est telle, qu’il doit être puni conformément à la discipline»
Et il prononça cette sentence: «Marcel, qui servait comme centurion ordinaire,
a renoncé publiquement à son serment, a dit qu’il en était souillé et a
prononcé d’autres paroles pleines de fureur, qui sont relatées dans le rapport
du préfet : nous ordonnons qu’il sera frappé du glaive»
J’ai traduit dans sa sécheresse la pièce officielle; un
autre document, sorti d’une plume chrétienne, nous fait connaître l’impression
produite sur les assistants par l’attitude de Marcel. Le vicaire Agricolanus
prenait, dit-on, une voix terrible pour intimider le chrétien; mais celui-ci,
en lui répondant, avait une autorité singulière, et semblait vraiment juger son
juge. L’effet fut si grand, que le greffier militaire Cassien, qui probablement
était chrétien déjà, n’yput tenir; dès qu’il e ut
entendu la sentence capitale, il jeta son style et ses tablettes. L’officium demeura stupéfait, pendant que Marcel
souriait, et qu’Agricolanus, sautant de son siège, demandait à Cassien raison
de sa conduite. «Tu as rendu une sentence injuste» répondit Cassien. Il allait
en dire davantage, expliquer probablement combien il était inique de chasser
les chrétiens de l’armée et de punir en même temps ceux qui s’en retiraient
d’eux-mêmes, quand le magistrat le fit saisir et mener en prison. Marcel,
cependant, fut immédiatement conduit au supplice; en passant devant le vicaire,
il s’écria: «Dieu te bénisse!» C’est ainsi, dit le narrateur, qu’il convenait à
un martyr de quitter ce monde. Cassien ne tarda pas à le suivre: un mois après,
le 3 décembre, il fut ramené devant Agricolanus, interrogé, et condamné à mort.
Parmi les soldats qui périrent dans les États de Maximien
Hercule sont probablement Emeterius et Chelidonius, immolés, nous apprend Prudence, à Calahorra,
très vieille ville romaine située sur l’Èbre, au nord de la Tarraconaise. Ils
moururent certainement avant la persécution de 303, puisque leurs Actes sont,
au témoignage du poète, au nombre des documents chrétiens qui furent détruits
dès le commencement de cette persécution par l’ordre de Dioclétien. Les
vraisemblances conduisent à mettre leur mort dans l’épuration militaire qui
précéda immédiatement cette grande crise. Peut-être reçurent-ils, comme leurs
camarades, l’ordre d’approcher des autels ou de quitter les drapeaux; quelque
fière réponse, quelque mouvement d’un noble et saint enthousiasme attira sur
eux l’attention du persécuteur, et leur mérita le martyre.
Prudence met dans leur bouche les paroles suivantes: «Nous,
créés pour le Christ, serons-nous consacrés à l’argent, et, portant la forme de
Dieu, servirons-nous le siècle? Non, que le feu céleste ne se mêle pas aux
ténèbres! Il doit suffire que notre vie, inscrite sur le rôle de la milice, ait
acquitté à César toute sa dette : le temps est venu de rendre à Dieu ce qui
appartient à Dieu. Allez, porte-étendards, et vous, tribuns, retirez-vous;
emportez les colliers d’or, prix de nos blessures; nous sommes appelés à servir
dans la brillante compagnie des anges. Là, le Christ commande des cohortes
vêtues de blanc, et, du haut de son trône, condamne vos dieux infâmes et
vous-mêmes, créateurs de ces dieux ou plutôt de ces risibles monstres» En
retranchant l'emphase poétique, ces paroles rappellent assez l'accent de celles
qu'à la même époque prononçait, dans une situation probablement semblable, le
centurion Marcel.
Emeterius et Chelidonius furent condamnés à mort. Ils étaient, disent
les traditions espagnoles, en garnison à Léon, et furent de là transférés à
Calahorra pour y subir le supplice. Prudence ne parle pas de cette translation:
il se peut que les deux soldats chrétiens aient confessé la foi à Calahorra, où
certainement ils souffrirent et furent enterrés. Le poète ne nous apprend pas
quel supplice ou leur infligea. «Ces détails, dit-il, ont été dérobés par un
long silence »
Les documents que nous avons étudiés n’ont point fait
encore allusion au sort des soldats chrétiens dans les provinces gouvernées par
Dioclétien. Quelques-uns furent martyrisés en Asie, mais durant l’expédition de
Galère contre les Perses, et par les ordres de ce César enflé d’une récente
victoire : ils appartenaient à son armée, sur laquelle il exerçait la juridiction
du général en chef, et qui parait avoir été composée pour une grande partie de
troupes levées aux bords du Danube. Dioclétien ne semble pas s’être associé
personnellement à la proscription des militaires chrétiens : dans ses États
comme dans ceux de Constance, ils étaient soufferts, pendant que les provinces
de Galère et d’Hercule les voyaient inquiétés. Peu de temps seulement avant
303, Dioclétien se décida à prendre contre eux des mesures. Lactance, qui
probablement se trouvait alors à Nicomédie, où l’empereur Pavait appelé pour
lui confier une chaire de rhétorique, nous fait connaître, en homme certainement
bien renseigné, la cause de ce premier changement dans l’esprit du vieil
Auguste.
Dioclétien était à Antioche, où la suscription de
plusieurs lois nous apprend qu’il séjourna en 302. Inquiet de l’avenir, que
l’audace croissante de Galère rendait menaçant à ses yeux, il offrait des
sacrifices, dans lesquels les haruspices interrogeaient les entrailles des
victimes. Parmi les serviteurs ou les officiers que leurs charges obligeaient
d'accompagner l’empereur, étaient plusieurs de ces chrétiens dont Eusèbe a
signalé la présence au palais. Un jour, quelque trouble avait interrompu le
sacrifice, et les ministres des dieux, même en multipliant les victimes, ne
voyaient point apparaître les signes accoutumés; le chef des haruspices, Tagis, ayant remarqué ou peut-être deviné que des
assistants avaient fait le signe de la croix, déclara que le silence des dieux
avait pour cause la présence de profanes. Dioclétien, furieux, donna à tous les
serviteurs du palais l’ordre de sacrifier, menaçant de la flagellation ceux qui
refuseraient. C’est alors que, poussé par la superstition, il consentit enfin à
suivre l’exemple de Galère, et à étendre aux soldats l’ordre sacrilège qu’il
venait d’intimer aux gens de sa maison. Des lettres furent envoyées par lui à
tous les chefs de corps, commandant de contraindre les soldats à sacrifier, et
d’exclure de l’armée ceux qui refuseraient. Mais il n’édicta pas d’autre
sanction, et les officiers des légions d’Asie, connaissant les intentions
encore débonnaires du maître, n’osèrent pas dépasser les instructions qu’ils
avaient reçues. Lactance, qui n’est point suspect de ménager Dioclétien, dit
qu’il n’y eut pas de sang versé, et que la seule peine infligée fut l’exclusion
de la milice ou la dégradation. «La colère de l’empereur s’arrêta devant cette
limite, et il ne fit rien de plus contre la loi divine ou la religion»
La trêve, cependant, était dénoncée. Dioclétien avait
enfin, sous une forme relativement modérée, commencé les hostilités contre les
chrétiens, auxquels depuis plusieurs années il témoignait tant de faveur. Il
faudra peu d’efforts désormais pour incliner tout à fait aux idées de
persécution son esprit déjà ébranlé. Aussi, quand, après avoir pris la mesure
que nous venons de rapporter, Dioclétien se fut rendu à Nicomédie pour y passer
l’hiver, Galère se hâta de le rejoindre, avec la résolution bien arrêtée de
pousser définitivement le superstitieux vieillard dans la voie où un premier
pas venait de l’engager.
LE PREMIER ÉDIT DE PERSÉCUTION GÉNÉRALE (343)
|
 |
 |
 |
 |