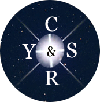 |
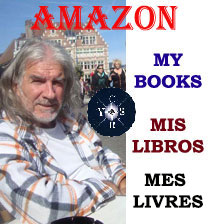 |
Amazon.com:LE CŒUR DE NOTRE-DAME MARIE DE NAZARETH:UNE HISTOIRE DIVINE |
LA PERSÉCUTION DE DIOCLÉTIEN ET LE TRIOMPHE DE L’ÉGLISE |
CHAPITRE TROISIEMELE PREMIER ÉDIT DE PERSÉCUTION GÉNÉRALE(343).1
La promulgation de l'édit et les événements de Nicomédie.
Galère passa les derniers mois de 302 et les premiers de
303 à Nicomédie, près de son beau-père Dioclétien. Excité lui-même par les
conseils de sa mère, cette fanatique paysanne qui haïssait les chrétiens, il ne
cessait, à son tour, de les dénoncer au vieil Auguste. Des colloques à leur
sujet avaient lieu quotidiennement entre les deux empereurs, dans le vaste
palais de Nicomédie encore tout peuplé de fidèles.
Pour échapper à la surveillance incessante que les
courtisans et les serviteurs exercent sur les souverains, l’Auguste et le César
se rencontraient dans l’ombre, comme des conspirateurs. Personne n’était admis
à leurs entretiens. On les croyait occupés des grands intérêts de l’État, de la
préparation des lois, de la marche des armées. Si quelqu’un, cependant, avait pu
surprendre leurs paroles à travers les portes soigneusement fermées, il eût
éprouvé pour l’un des deux interlocuteurs cette sorte de sympathie dans
laquelle il entre un peu d’estime et beaucoup de pitié. A Galère méprisant et
impérieux Dioclétien répondait lentement, en vieillard qui défend pied à pied
sa politique, son œuvre, sa fortune contre un héritier impatient de tout
bouleverser. Il montrait les païens et les chrétiens unis dans une commune
obéissance aux lois, le monde jouissant partout de la paix religieuse, et
suppliait le furieux César de ne pas détruire un si bel ordre, fruit de
dix-huit ans de sagesse. Rendu humain par les années et par le long exercice du
pouvoir, il parlait de sa répugnance à verser le sang, de la facilité avec
laquelle les chrétiens affrontaient la mort, de l’affreux carnage
qu’entraînerait une déclaration de guerre à l’Église. Mais aucune considération
d’humanité ou de politique ne pouvait arrêter Galère. En vain Dioclétien lui
offrait une sorte de transaction: on continuerait à chasser les chrétiens de
l’armée, on exclurait même du palais les courtisans, les employés et les
serviteurs qui professaient leur foi; à ce prix, la masse de la population chrétienne
ne serait pas inquiétée. Galère ne voulut rien entendre, et ne se contentait
pas à moins d’une proscription universelle.
Las de résister, Dioclétien demanda que la responsabilité
d’une décision fût partagée. Il aimait à garder pour lui le mérite de ses
bonnes actions; mais, se voyant acculé à la nécessité de faire mal, il ne s’y
résignait qu’à la condition d’y paraître contraint par un semblant d’opinion
publique. Sur ces bases, l’entente se fit aisément: d’un commun accord on
décida de mettre fin au secret dont avaient été jusque-là enveloppées les
délibérations des deux empereurs. Quelques fonctionnaires civils et militaires
furent convoqués en conseil privé, afin de statuer sur le sort des chrétiens.
Le résultat fut ce qu’on pouvait attendre. Chacun parla à
son tour, d’après son rang et son grade. Plusieurs de ces conseillers
partageaient les haines ou les préjugés de Galère. Il y avait parmi eux des magistrats
civils, imbus des principes néoplatoniciens, et voyant dans le christianisme
une secte rivale de leur philosophie. Lactance cite le plus influent et le plus
passionné, cet Hiéroclès dont nous avons parlé déjà,
et dont le nom se retrouvera encore dans l’histoire de la persécution.
Peut-être la rivalité philosophique n’animait-elle pas seule de tels hommes, qui
avaient souffert avec indignation la concurrence de collègues chrétiens dans le
gouvernement des provinces, la direction des finances ou l'administration des
cités, et saisissaient avec joie l'occasion de leur fermer l'accès des
carrières publiques. On peut croire que les militaires appelés au conseil y
portaient des sentiments moins complexes. C'étaient probablement des camarades
et des admirateurs du vainqueur de la Perse, unissant comme lui à la vaillance
guerrière une complète ignorance ou un grossier dédain des choses de l'âme.
Ceux-ci votèrent de bonne foi l’extermination des ennemis des dieux, des
adversaires de la religion nationale. D'autres conseillers, qui ne pensaient ni
comme les amis d’Hiéroclès, ni comme les compagnons
d’armes de Galère, se prononcèrent dans le même sens. Habitués à lire dans la
pensée impériale, ces habiles gens avaient compris que le débat s'agitait entre
une volonté inflexible et une volonté défaillante, et que la première
triompherait de tous les obstacles : soit par crainte de déplaire, soit par
désir de flatter, ils sacrifièrent les chrétiens sans hésitation, sinon sans
remords. La race des Pilate n’était pas éteinte après trois siècles: ses
imitateurs tremblaient, comme lui, de ne pas paraître assez «amis de César»
Le malheureux Auguste, cependant, ne céda pas encore tout
à fait. Il cherchait à retarder l'acte impolitique et cruel qu’on exigeait de
sa faiblesse. Il résolut ou plus probablement on lui suggéra une démarche dont
l’issue ne pouvait être douteuse. Un haruspice (peut-être un de ceux-là mêmes
qui naguère l’avaient décidé à expulser les soldats chrétiens) fut envoyé par
lui à Milet pour consulter l’oracle d’Apollon Didyméen.
Celui-ci «répondit en ennemi de notre divine religion» nous apprend simplement
Lactance. Constantin, qui vivait alors près de Dioclétien, donne des détails
plus précis. L’oracle caché au fond de l’immense et magnifique temple se
plaignit d’être réduit à l’impuissance. Des justes répandus sur la terre
l’empêchaient d’annoncer l’avenir : du trépied sacré ne tombaient plus que des
avis trompeurs. Se lamentant de sa déchéance, le prêtre d’Apollon agitait ses
cheveux hérissés, comme en proie à l’esprit du dieu. Cette parole ambiguë,
cette plainte étrange fut rapportée à Dioclétien. Son esprit naturellement
superstitieux en resta plus frappé que d’une réponse directe. Il interrogea,
dans son trouble, les personnes qui l’entouraient, officiers du palais ou
prêtres païens. On fut unanime à reconnaître les chrétiens dans les justes
dénoncés par Apollon. Sans prendre garde à l’hommage involontaire rendu à la
vertu de ceux qu’on lui demandait de proscrire, Dioclétien sentit ses
hésitations dissipées. Il avala ces paroles comme du miel, dit Constantin.
Désormais la lutte pénible qu’il soutenait avec les autres et avec lui-même
était terminée. Ne pouvant résister à ses amis, à César et à Apollon ligués
ensemble, il se rendit. En échange de sa défaite, il obtint à son tour une
concession. Le fanatique Galère avait demandé que tous les chrétiens fussent
mis en demeure de sacrifier aux dieux, et ceux qui refuseraient brûlés vifs;
Dioclétien essaya de rester modéré dans l'injustice, et voulut que la persécution
enfin décidée n'entrainait pas d'effusion de sang. Galère l'accorda : il savait
bien qu'il ne dépendrait que de lui de faire naître ensuite quelque incident,
par où les intentions de l'empereur seraient encore une fois changées.
On se hâta d'engager celui-ci dans la voie de la
violence. Avant même que l'édit de persécution fût lancé, un premier acte
d'hostilité eut lieu à Nicomédie, par l'ordre et sous les yeux de l'Auguste et
du César. Le jour fut choisi avec ce mélange de superstition et de subtilité
qui caractérise une époque de décadence. Le sept de calendes de mars (23
février) était la fête des Terminalia,
destinée à célébrer les limites des champs, et marquée par des sacrifices à,
Jupiter Terminus. Il parut que cette date conviendrait à une solennelle
démonstration contre le christianisme, arrivé, dans la pensée des empereurs, à
la limite extrême, au terme définitif de son existence.
Dès le point du jour, à la lumière encore douteuse du
crépuscule, une troupe armée se mit en marche: le préfet du prétoire la
commandait, accompagné de chefs supérieurs et de tribuns, comme pour une expédition
militaire; des agents du fisc suivaient, car il s’agissait aussi d’un acte de
confiscation et de pillage régulier. On arrive à la principale église. Les
portes sont arrachées: les soldats se répandent dans le saint lieu, cherchant,
disent-ils, la statue du dieu des chrétiens. Cette vaine recherche les
conduisit à la tribune absidale, sur laquelle s’ouvraient les armoires ou
chambres destinées à contenir d’un côté les vases sacrés, de l’autre les
saintes Écritures, les livres liturgiques, les ouvrages composant la
bibliothèque de l’église. Ils jetèrent au feu tous les manuscrits, et se
partagèrent les objets précieux. La basilique était remplie de soldats et
d’employés, pillant, s’agitant, courant çà et là. Durant cette scène de
désordre, les deux empereurs se tenaient à une fenêtre du palais, d’où ils
apercevaient l’édifice chrétien, construit sur une hauteur. Longtemps ils
délibérèrent sur son sort. Galère, toujours porté aux mesures extrêmes, voulait
qu’on le brûlât. Dioclétien résistait, craignant que de l’église l’incendie se
communiquât aux maisons contiguës, et que tout un quartier de Nicomédie, plein
de grands et beaux monuments, périt avec elle. Enfin son avis prévalut: on se
contenta d’envoyer une escouade de prétoriens chargés de la démolir. Ils
s’avancèrent en ordre de bataille, la hache et les outils â la main,
investirent l’église, et, avec l’adresse des soldats romains exercés à tous les
travaux, commencèrent à renverser les murailles. En peu d’heures la haute
cathédrale fut rasée .
Le lendemain, païens et chrétiens pouvaient lire sur les
murs de Nicomédie l’édit de persécution. Il contenait quatre articles principaux.
Les assemblées chrétiennes étaient absolument interdites. Les églises devaient
être abattues . Les livres sacrés qu’elles contenaient ou que possédaient les
clercs et les fidèles devaient être jetés au feu. Les chrétiens de rang élevé
perdaient tous leurs privilèges, et tombaient à la condition de personnes
infâmes; en conséquence ils pourront être mis à la torture, devenir l’objet de
toutes les poursuites, et n’auront le droit d’intenter aucune action devant un
tribunal, même pour injure, adultère, ou vol. Quant aux fidèles n’appartenant
point à l’aristocratie ou au monde officiel, ils perdaient la liberté, s’ils
persistaient à se dire chrétiens. Ceux qui étaient déjà esclaves ne pourront
jamais être affranchis.
Par quelques dispositions cet édit rappelle celui que
Valérien promulgua en 258. Comme alors, les chrétiens illustres par la
naissance ou les fonctions sont dégradés. Mais sur divers points la législation
de Valérien est aggravée. Les édifices ecclésiastiques ne seront pas seulement
séquestrés, mais détruits. Une clause spéciale ordonne la suppression des
livres, dont Valérien n'avait pas parlé. Enfin, sous cet empereur, seuls les
chrétiens de la maison de César devenaient esclaves du fisc; maintenant tous
les gens du peuple qui persisteront dans la croyance prohibée pourront être
revendiqués par lui, et tous les esclaves chrétiens seront à jamais rivés à la
servitude.
Sur d'autres points, au contraire, Dioclétien se montre
moins rigoureux que Valérien: son édit ne fait pas mention du clergé, que cet
empereur en 257 punissait de l'exil, en 258 de la mort; il n'inflige pas non
plus ce dernier châtiment aux chrétiens de haut rang qui, après leur
dégradation, refuseraient d’abjurer. La peine de mort n’est encore prononcée
nulle part: c'était, on s'en souvient, la concession que Dioclétien avait
obtenue de Galère.
La lecture de l'édit impérial dut exciter dans la
population chrétienne des sentiments divers: chez les faibles, la consternation
et la stupeur; chez les saints, une ferme résolution et même une pieuse allégresse;
chez les jeunes, les ardents, une indignation généreuse. Les historiens
rapportent d’un de ceux-ci un acte incorrect, sans doute, selon la rigueur de
la règle, mais trop courageux pour qu’on lui puisse refuser l'admiration. Un
chrétien distingué par sa naissance et ses emplois ne put lire avec calme la
pièce hypocrite par laquelle il voyait une partie des fidèles atteinte dans ses
privilèges, une autre partie menacée dans sa liberté. En public, sur le forum,
il arracha la copie de l’édit et la mit en pièces, s'écriant: «Voilà donc, ô
empereurs, vos victoires sur les Goths et les Sarmates!» L'acte était outrageant
pour la majesté impériale; peut-être le reproche politique contenu dans ces
mots, allusion railleuse aux titres de Gothique et de Sarmatique pris par les
empereurs, mais surtout blâme contre des souverains assez mal inspirés pour
employer contre leurs sujets les plus soumis une énergie mieux faite pour
combattre les Barbares, toucha-t-il davantage Dioclétien. L'intrépide chrétien
fut arrêté sous l’inculpation de lèse-majesté commise à la fois par les actions
et par les paroles. On le mit tout de suite à la torture, non pas tant par
application de l'édit qu’en vertu du droit commun : dès qu'un crime de cette
sorte était découvert, le coupable, sans égard au rang ou à la naissance,
devait être torturé sur-le-champ, afin de rechercher quels étaient ses complices,
de quelle faction il se faisait l'instrument; les ennemis du christianisme ne
laissèrent pas échapper une aussi excellente occasion de mettre en suspicion
tous les fidèles pour le fait d'un seul. Puis on condamna le coupable au feu,
selon la loi, dit Lactance. La loi punissait le crime de lèse-majesté de peines
différentes, suivant la condition des personnes: les humbles, humiliores, étaient livrés aux bêtes ou brûlés vifs;
les gens distingués, honestiores, étaient
décapités. Déchu de son ancienne dignité en vertu d'une des dispositions de
l'édit, le chrétien, noble encore la veille, n'était plus maintenant qu'un humilior : comme tel il fut conduit au bûcher. Sa
joie et sa tranquillité persistèrent jusqu'au dernier soupir.
Le procès terminé par cette exécution n'avait amené
aucune charge contre les fidèles. L'acte illégal si cruellement expié par l’un
d'eux émanait certainement de lui seul. Galère dut chercher ailleurs le moyen
de compromettre la population chrétienne. Tout à coup le feu éclata dans le
palais que l'Auguste et le César habitaient ensemble à, Nicomédie. L’incendie
s'alluma si soudainement, que plusieurs l’attribuèrent à la foudre: telle était
encore, bien des années plus tard, l'opinion de Constantin. Eusèbe parle d'un
cas fortuit, sans marquer lequel. Lactance n'hésite pas à dénoncer Galère: soit
que ses affidés aient mis directement le feu, soit qu'ils aient entretenu
l'incendie accidentel que la foudre ou quelque autre hasard avait produit.
Quand même la passion aurait ici égaré l’historien, il ne se trompe pas en nous
montrant le haineux et perfide César profitant avec habileté d'un événement qui
avait porté la terreur jusqu'au fond de l'âme de son timide collègue. Si Galère
n'alluma pas le feu, il le fit si bien servir à ses vues, qu’on serait
excusable de l'avoir soupçonné. «Le palais, s’écriait-il devant les murailles
embrasées, le palais est rempli d'eunuques chrétiens; ils ont voulu payer par
le crime la confiance aveugle que leur montrait Dioclétien: un complot a été
formé entre eux et leurs coreligionnaires du dehors; grâce à cet accord
scélérat, deux empereurs ont failli périr dans les flammes! Les chrétiens ont
enfin paru ce qu'ils sont en effet : des ennemis publics!» Dioclétien, malgré
sa finesse de vieux politique, ne devina pas la ruse, peut-être le crime de
Galère. La fureur obscurcit son habituelle pénétration. Il fit mettre tous ses
gens à la torture. Lui-même siégeait au milieu des bourreaux et voyait d’un œil
sec les membres des accusés se tordre sous l'action des flammes. Tous les
magistrats présents à la cour avaient été requis, et chacun, de son côté,
administrait la question. C'était à qui découvrirait les coupables. Galère
était présent, entretenant la colère de son collègue, ne lui laissant pas le
loisir de réfléchir ou de se calmer. Mais il avait eu soin de dérober à l’enquête
et à la torture ses propres serviteurs: c’est pour ce motif, dit malicieusement
Lactance, qu’on ne put rien découvrir. Les poursuites allaient-elles être
abandonnées? Le César n’était pas homme à subir un tel échec. Il fallait à tout
prix le conjurer. Quinze jours après le premier incendie, un second éclata.
Galère, qui depuis le milieu de l’hiver avait fait en secret ses préparatifs de
départ, quitta le jour même Nicomédie, déclarant qu’il fuyait de peur d’être
brûlé vif.
Malgré les plus promptes recherches, le coupable fut
encore introuvable. Lactance persiste à désigner Galère. Si la participation du
César au premier incendie reste douteuse, il semble difficile de le disculper
du second. Galère n’était pas homme à reculer devant un aussi lâche moyen de
compromettre ses ennemis: on ne saurait prétendre que des considérations
d’humanité ou de prudence l’eussent arrêté, lui qui, naguère, avait voulu
brûler l’église de Nicomédie au risque de détruire un quartier de la ville. Sa
fuite même, par laquelle il accusait avec ostentation les chrétiens, parait
suspecte: emmenant ses officiers et ses serviteurs, il les mettait à l’abri
d’une nouvelle enquête qui eût pu tourner contre lui si Dioclétien s’était
avisé de faire, cette fois, interroger sans distinction tous les hôtes du palais.
La précaution, cependant, était superflue: Dioclétien n’éprouvait plus
d’hésitation. La peur avait eu raison de sa sagesse. Il était maintenant
crédule à toutes les calomnies. Il jugeait sa vie menacée: et par qui l’eût-elle
été, sinon par ces chrétiens que Galère lui avait dénoncés comme des ennemis
publics, et dans lesquels son imagination troublée voyait désormais les secrets
alliés des Goths et des Sarmates? Le vieux souverain se figurait être enveloppé
dans les filets d’une vaste conjuration: le clergé de Nicomédie en était l’âme,
et les serviteurs baptisés de tout état et de tout rang qui remplissaient la
demeure impériale y prêtaient leurs bras! Ses défiances montaient plus haut
encore: il se demandait si sa femme Prisca, si sa fille Valeria, l’épouse
délaissée que Galère n’avait pas songé à emmener dans sa fuite, ne faisaient
pas partie, elles aussi, du complot. En un mot, tous les chrétiens de son
entourage et de sa capitale, même les plus illustres, même les plus chers, lui
paraissaient conjurés contre lui. Aussi résolut-il de changer la procédure
suivie lors du premier incendie. Au lieu de faire porter l’enquête sur le fait lui-même,
il la mit sur la religion. Ceux qui nieront le Christ démontreront par là leur
innocence; ceux qui le confesseront s’avoueront coupables de conspiration
contre la personne sacrée des empereurs et seront punis comme incendiaires. On
revenait aux jours de Néron : la dernière des persécutions débutait comme avait
fait la première.
Les souffrances des chrétiens furent à Nicomédie presque
aussi cruelles qu’elles l’avaient été après l’incendie de Rome : non que
Dioclétien se complût aux horribles mascarades inventées alors par l’histrion
couronné du premier siècle; mais il était trop romain pour hésiter à verser le
sang, et, comme il arrive souvent aux gens qui ont eu peur, il était devenu
d’autant plus impitoyable qu’il avait été plus effrayé.
Ou sacrifier, ou mourir: tous les suspects, c’est-à-dire
tous les chrétiens de la cour et de la ville, durent choisir entre ces deux
termes. Les défaillances paraissent avoir été peu nombreuses, du moins l’histoire
n’en a retenu qu’une, celle des deux impératrices. La nombreuse domesticité
chrétienne montra un grand courage. Les plus puissants des eunuques, «sur
lesquels reposait tout le palais» qui avaient possédé la confiance du maître et
été aimés de lui comme des fils, se laissèrent tuer plutôt que de trahir leur
foi. Eusèbe a décrit le supplice du chambellan Pierre. Après son refus de
sacrifier, on l’éleva sur le chevalet, et on lui déchira tout le corps avec des
fouets. Quand ses os parurent à nu, du sel et du vinaigre furent mis dans les
plaies. Puis on l’étendit sur un gril, pour consumer à petit feu ce qui lui
restait de chair. Il mourut ainsi, «inébranlable comme son nom». Dorothée, chef
des chambellans, Gorgone et beaucoup d’autres cubiculaires furent étranglés
après de longues tortures. L’empereur assistait en personne à l’exécution de
ses serviteurs. Il ne s’opposa point d’abord à ce qu’une sépulture convenable
leur fût donnée. Mais bientôt il changea d’avis : craignant, dit Eusèbe, que la
dévotion populaire ne s’attachât à leurs tombes, et qu’on ne les honorât comme
des dieux, il commanda de déterrer et de jeter à la mer les restes des martyrs.
Lactance, avec son éloquence vengeresse, compare Dioclétien à la bête féroce
qui fouille les tombeaux et s'acharne sur les cadavres. «Qu'importe? s’écrie le
vigoureux polémiste. Est-ce qu’on s’imagine que ceux qui souffrent la mort pour
le nom de Dieu se mettent fort en peine que l’on vienne à leurs sépulcres?
S’ils veulent mourir, c’est pour aller eux-mêmes à Dieu»
Pendant que Dioclétien immolait dans le palais ses
anciens amis, la terreur pesait sur la ville. Des juges se tenaient dans les
principaux temples, obligeant tous les suspects à sacrifier, condamnant à mort
ceux qui refusaient. Ni le sexe ni l’âge n’exemptaient de cette épreuve.
Cependant, un certain ordre semble avoir été suivi. On commença par le clergé.
L’évêque Anthime, ses prêtres, tous les ministres des autels, furent jugés
sommairement et exécutés, les uns par le glaive, d’autres par des supplices divers.
Avec eux périrent toutes les personnes de leur maison, parents ou domestiques,
les femmes mêmes et les enfants, massacrés en masse: tantôt on les mettait dans
des barques et on les jetait en pleine mer, une pierre au cou; tantôt on les
entourait de bois enflammé et on les brûlait par troupes. Un saint enthousiasme
saisissait quelquefois les condamnés : on vit des hommes et des femmes sauter
d’eux-mêmes dans le feu.
Pendant ce temps les prisons ne cessaient de s’emplir.
Après les clercs et leurs familles, les laïques passèrent à leur tour en
jugement. Des supplices inouïs furent inventés. On ne sait si ce tragique
épisode se termina par la complète extermination de la population chrétienne de
Nicomédie, ou par la lassitude de l’empereur et des bourreaux. J'incline à cette
dernière opinion. Lactance rapporte, en effet, que des autels furent placés
dans les prétoires, afin que les juges pussent s'assurer de la religion des
plaideurs. Cette mesure, si tyrannique qu’elle soit, montre qu’on revint après
quelque temps à l’application régulière de l’édit, qui frappait les chrétiens
de mort civile et non de mort sanglante: quand un plaideur, avant d’exposer son
procès, refusait de brûler de l’encens, le juge le renvoyait de l’audience en
vertu de la clause qui retirait aux chrétiens le droit d’ester en justice. Il
restait donc encore de ceux-ci à Nicomédie, après les affreux massacres
auxquels le second incendie du palais servit de prétexte.
II
L’exécution de l’édit.
L'édit avait été rendu au nom des deux Augustes et des
deux Césars : mais il était l'œuvre des seuls Dioclétien et Galère : leurs
collègues n'avaient pas été consultés, et n'apprirent un acte aussi considérable
que par un message qui leur fut envoyé de Nicomédie. Sa publication fut donc
assez tardive en Occident. Même dans les provinces orientales, elle n’eut pas
lieu partout à la même époque. En Palestine, l'édit ne fut connu qu'aux
approches de la Passion du Sauveur, vers la fin de mars ou le commencement
d’avril; à Antioche, il fut exécuté, par la fermeture des églises, le jour même
de la Passion, qui se trouvait, en 303, le 16 avril. Près de deux mois
s'étaient écoulés depuis la destruction de l’église de Nicomédie.
Si l’on se rappelle les détails donnés par Eusèbe sur le
relâchement où étaient tombés, à la faveur de la paix, beaucoup des fidèles des
Églises orientales, on comprendra que la connaissance de l’ordre impérial ait
produit parmi eux de nombreuses défections. Autant les chrétiens de Nicomédie,
animés par l’exemple de leur évêque, s’étaient montrés héroïques, autant ceux
d’Antioche, privés de leur pasteur Cyrille, qui venait d’être déporté aux mines
de Pannonie, marquèrent de faiblesse. Bien qu’un traitement moins cruel les
menaçât, puisque la peine de mort, appliquée à Nicomédie à la suite de circonstances
exceptionnelles, ne devait pas l’être ailleurs, on les vit déserter en foule
les autels du vrai Dieu et offrir des sacrifices aux idoles .
Peut-être cette honteuse déroute eut-elle, sinon pour
excuse, au moins pour cause la terreur inspirée par la présence de Galère, qui,
après sa fuite retentissante, s’était rendu à Antioche. Cependant ce troupeau
sans chef finit par rencontrer un homme capable de le rassembler et de le
conduire. Romain, diacre de Césarée, se trouvait à ce moment dans la capitale
de la Syrie. Ému du triste spectacle qui s’offrait à ses regards, il résolut de
ranimer la foi défaillante des chrétiens. Il y travailla avec succès par ses exhortations
publiques, par des discours prononcés jusque sur les marches des temples, d’où
il écartait les hésitants, où il allait chercher les apostats pour les ramener
au devoir. Mais l’intervention généreuse de cet étranger parut aux autorités
publiques un acte de rébellion. Romain, arrêté, fut condamné au feu. Le cruel
Galère, pour qui la mort d’un chrétien était une fête, voulut assister à
l’exécution. Déjà le martyr, attaché à un poteau, était environné de flammes,
quand une pluie soudaine éteignit le bûcher. «Où donc est le feu?» demanda
Romain en riant. La raillerie déplut à l’empereur, qui commanda de couper la
langue de l’intrépide diacre. Un médecin renégat fut obligé de faire
l’opération. Contrairement à toutes les prévisions, Romain n’en mourut pas;
conduit en prison, il parlait clairement. Le médecin, soupçonné de
complaisance, se justifia en montrant la langue du martyr, qu’il avait conservée
comme une relique : un condamné, sur qui l’on expérimenta le même supplice,
mourut aussitôt. Romain, que Dieu venait de glorifier par un si éclatant
miracle, fut gardé pendant de longs mois en prison: nous le verrons plus tard y
consommer son martyre.
Cet épisode méritait d’être recueilli, car les renseignements
sont rares sur les effets du premier édit dans les États de Dioclétien. Ils se
laissent surtout deviner, grâce à des témoignages indirects. On reconnaît que beaucoup
d’églises furent abattues en Asie, au soin avec lequel, dés le lendemain de la paix, les évêques les rebâtirent de toutes parts. Ce sont
surtout les constructions neuves de l’âge postérieur qui racontent les ruines
de 303. Si nous possédions les discours prononcés pour l’inauguration des
nouveaux sanctuaires, nous apprendrions sans doute, au sujet de ceux qu’ils
remplaçaient, ce que raconte le «panégyrique» par lequel on célébra la dédicace
de la seconde cathédrale de Tyr: l’ancien édifice, déjà magnifique dans son
état primitif, avait été entièrement ravagé après l’édit de Dioclétien; on
avait vu ses portes abattues à coups de hache, ses livres détruits, ses
murailles incendiées; sur ses décombres s’était établi un dépôt d’immondices.
Il faudrait, cependant, mal connaître l’administration
romaine pour s’imaginer que la démolition des églises chrétiennes eut lieu
partout en même temps, et fut aussi complète dans toutes les provinces. Les
gouverneurs ne ressemblaient que de loin à nos préfets. Une latitude beaucoup,
plus grande leur était laissée dans l’exécution des lois. Ils les appliquaient
plus ou moins complètement, selon les lieux, et en considérant soit leurs
dispositions personnelles, soit celles des peuples qu’ils administraient.
Servie par des moyens de communication moins rapides, la centralisation
impériale n’avait pas les exigences de celle de nos jours: l’unité de l’action
générale, non l’uniformité presque mécanique des mouvements particuliers, était
demandée à ses agents. Aussi voyons-nous, pendant plusieurs mois, pour des
causes diverses, des églises rester debout en certaines contrées, malgré l’édit
qui commandait leur destruction. Peu nombreuses apparemment sont celles qui
échappèrent tout à fait à la ruine, comme l’église bâtie au siècle précédent
par saint Grégoire le Thaumaturge à Né césarée du
Pont; mais, en d’autres contrées, cette ruine parait avoir été retardé : il en
fut ainsi même dans des provinces assez voisines de la résidence impériale.
En Galatie, par exemple, on nous dit qu’il y avait
encore, un an après l’édit, à quinze lieues il est vrai de la capitale, une
église de campagne non seulement debout, mais ouverte; à Ancyre même, vers la
même date, les églises étaient fermées, mais non rasées, comme portait
cependant l’ordonnance impériale. Cela parait, à première vue, d’autant plus
surprenant qu’au gouvernement de cette province fut appelé le renégat Théotecne, qui s’était fait fort de ramener au culte des
dieux tous les chrétiens qui l’habitaient. Mais sa nomination ne suivit
peut-être pas immédiatement l’édit. Qui sait s’il ne remplaça point un
gouverneur soit chrétien, soit au moins favorable aux chrétiens? La présence
d’un administrateur animé de tels sentiments parait avoir été la cause du
retard que subit, en Thrace, la persécution. Nous verrons que la principale
église d’Héraclée ne fut fermée qu'au commencement de 304. Une aussi longue
patience serait inexplicable sans ce que l’on sait du gouverneur Bassus. Une pièce ancienne semble dire qu’il «connaissait
Dieu» Au moins sa femme était-elle chrétienne. Lui-même descendait peut-être de
ce Iallius Bassus qui fut
en 164 gouverneur de la Mésie Inférieure et dont la fille était enterrée dans
le cimetière de Calliste: les sympathies pour le christianisme ne cessèrent
probablement jamais dans cette famille et les Bassi du quatrième siècle sont
célèbres par leur piété.
Si, en dehors des événements de Nicomédie, l’on a peu de
détails sur les débuts de la persécution dans les États de Dioclétien, les
renseignements sont moins nombreux encore sur ses commencements dans les
provinces gouvernées par Galère. Comme le César demeura quelque temps en Asie
avant de retourner dans son apanage, peut-être faut-il attribuer à son absence
la langueur avec laquelle s’engagèrent les poursuites. Il parait cependant qu’à
Thessalonique, capitale de la Macédoine, la recherche des Écritures saintes et
de tous les livres composant la bibliothèque des églises fut faite
rigoureusement. C’est alors qu’une chrétienne dévouée, Irène, avant de s’enfuir
dans les montagnes, cacha dans sa maison, avec l’aide de ses sœurs, un grand
nombre de manuscrits; nous retrouverons ces saintes femmes dans la suite de
cette histoire. On rapporte aussi au commencement de la persécution (mais
peut-être la date n’est-elle pas bien assurée) le martyre, à Thessalonique, du
diacre Agathopode et du lecteur Théodul ; arrêtés parce qu’au lieu de s’enfuir comme les autres ils restaient dans
l’église et prêchaient hardiment, les deux clercs furent conduits en prison,
pressés de sacrifier, de manger des viandes immolées et de livrer les Ecritures:
sur leur refus, le juge les fit mettre dans une barque, une pierre au cou, et
jeter dans la mer. Bien qu’aux termes de l’édit la qualité de chrétien ne fit
pas encore encourir la mort, la peine capitale était quelquefois prononcée
contre des chrétiens plus hardis qui encourageaient les autres à la résistance,
ou contre ceux qui, mis en demeure de livrer les ouvrages proscrits, refusaient
de le faire. Dans ces derniers étaient naturellement Agathopode,
chargé comme diacre du temporel de l’église, et Théodule, investi spécialement
du soin des livres.
Si de l’Orient, où la persécution prit naissance, nous
passons à l’Occident, où ses effets se firent bientôt sentir, nous verrons que
ceux-ci ne furent pas les mêmes dans les États des deux souverains qui se partageaient
cette moitié de l’Empire.
Les sujets chrétiens de Constance l’éprouvèrent assez
pour s’apercevoir qu’elle avait été déclarée, à peine assez pour en souffrir.
Le César ne pouvait sans doute refuser toute obéissance aux commandements de
ses supérieurs, les Augustes, ou toute attention à un édit en tête duquel son
nom se lisait avec ceux de ses trois collègues. Mais il en adoucit l’exécution
au point de la rendre presque insensible.
Eût-il partagé la haine des autres empereurs pour le
christianisme, la politique aurait suffi à le détourner d’y donner cours. Moins
puissante et moins répandue en Bretagne et même en Gaule qu'en Orient, l’Église
ne prêtait dans ces contrées aucun prétexte aux craintes imaginaires que les
souverains avaient manifestées ailleurs. Jamais un acte quelconque d'opposition,
un refus de service militaire, par exemple, ne s'était produit parmi les
paisibles chrétientés bretonnes ou gallo-romaines. Les souvenirs mêmes de la
tyrannie de Maximien Hercule n'y avaient point laissé de ressentiment dans les
âmes, facilement réconciliées avec l'Empire par la bienfaisante administration
de Constance. La prudence conseillait à celui-ci de ne pas éveiller les
passions par une persécution nouvelle, qui, pour être d'abord moins meurtrière
que le court orage de 287, serait pourtant plus insupportable, parce qu'au lieu
de frapper quelques chrétientés seulement elle les atteindrait toutes. Le César
se sentait aimé et vénéré de tous ses sujets, sans distinction de culte: cette
popularité, contrastant avec les haines qu’avaient attirées sur Dioclétien et
sur Hercule les exactions fiscales du premier, les cruautés et les débauches du
second, lui était chère, et il ne voulut pas la perdre. Par inclination autant
que par politique, il résolut de préserver ses provinces des maux qui
désolaient déjà l'Orient et allaient fondre sur une partie de l’Occident.
Ne voulant pas, cependant, rompre ouvertement avec ses
collègues, Constance leur donna un témoignage matériel de soumission par la
destruction de quelques églises. Mais, au prix de quelques murailles, qu'il
sera facile de relever, il se dispensa d’attenter au vrai temple de Dieu, qui
est dans le cœur des hommes; il ne demanda pas aux membres du clergé de livrer
les Écritures sacrées; en un mot, il laissa voir clairement sa résolution de
respecter autour de lui la liberté des consciences. Si, alors ou plus tard, des
excès furent commis dans ses États contre les chrétiens, cela eut lieu à son
insu, par la tyrannie locale d'un petit nombre de gouverneurs; mais la direction
générale donnée par Constance à sa politique religieuse fut toute dans le sens
de la tolérance. Alors que les palais de ses collègues ne contenaient plus un
seul officier ou serviteur chrétien, le sien, qui en était rempli, continua de
ressembler à une église, dit Eusèbe, répétant une expression naguère employée
par saint Denys d’Alexandrie à propos d’un autre empereur favorable au
christianisme. Si l’on en croit l’historien, Constance donna même une noble et
spirituelle leçon aux courtisans qui croient faire preuve de fidélité aux
princes en réglant leur conscience sur les ordres de ceux-ci. Il feignit
d’imiter Dioclétien, et d’exiger comme lui de tous ceux qui l'entouraient une
adhésion au paganisme. «Employés du palais, magistrats, gouverneurs, les
chrétiens qui obéiront, dit-il, continueront de jouir de leurs honneurs et
privilèges, mais ceux qui refuseront perdront leurs charges». Les uns se
montrèrent disposés à l’obéissance; d’autres refusèrent de renier le Christ.
Quand le prince eut ainsi pénétré le caractère de chacun, il blâma les premiers
de leur faiblesse et se plaignit de ne pouvoir compter pour lui-même sur la
fidélité d’hommes capables de renier leur Dieu. Ceux-ci furent, en conséquence,
exclus de la cour, tandis que les chrétiens courageux qui s’étaient, par
devoir, exposés à déplaire restèrent en possession de la faveur du loyal César.
Maximien Hercule différait trop de Constance pour ne pas
accueillir avec joie la persécution. Aussi, tandis qu'en Bretagne et en Gaule
la paix religieuse était à peine troublée, l'édit fut rigoureusement appliqué
dans les États du second Auguste, c'est-à-dire en Italie, en Afrique et en
Espagne.
Pour ce dernier pays, nous avons le témoignage du poète
Prudence, qui montre les soldats pillant les livres sacrés, et attribue à la
destruction de documents qui eut lieu alors l'oubli où tomba la mémoire des
anciens martyrs.
La guerre aux manuscrits ne fut certes pas moindre à
Rome. Mais nous manquons de détails sur ce qui s'y passa. Les seuls qui nous
soient parvenus découlent d'une source suspecte. Il y aurait eu dans cette
capitale du monde chrétien de nombreux «traditeurs» si l’on en croit des
procès-verbaux allégués un siècle plus tard par les donatistes. Cependant, deux
seulement y sont désignés par leurs noms, Straton et Cassien. Les donatistes
accusent, il est vrai, le pape Marcellin, ses prêtres Miltiade, Marcel, Silvestre,
d’avoir livré les Écritures; mais aucune pièce n’est apportée à l’appui de
cette assertion. Saint Augustin la repousse comme dénuée de preuves. Nous
verrons tout à l’heure les habiles et laborieux efforts de Marcellin pour
dérober aux profanateurs les sépultures les plus vénérées des catacombes. Apparemment,
si la police romaine avait dû recourir à la trahison ou à la faiblesse pour se
faire livrer les manuscrits, ce n’aurait été que dans quelques-unes des églises
paroissiales ou tituli, situées pour la plupart
dans les quartiers excentriques de la ville: les plus anciennes, n’étant point
distinguées par leur architecture comme les somptueuses basiliques de l’Orient,
pouvaient être jusque-là demeurées inconnues de l’autorité civile. Mais
celle-ci avait entretenu des rapports officiels avec le chef de la communauté
chrétienne: elle connaissait certainement l’existence des archives et de la
bibliothèque pontificales, situées dans un des lieux les plus fréquentés de la
ville, près du théâtre de Pompée et des écuries de la faction Verte des jeux du
cirque. Sans doute elle n’eut besoin d’aucun délateur pour s’emparer d’un dépôt
déjà considérable à cette époque, et que sa richesse même n’avait pas dû
permettre de déménager furtivement. Le petit nombre des Actes, des documents,
des écrits antérieurs au quatrième siècle qui nous soient restés d’un siège
mêlé comme celui de Rome aux affaires de la chrétienté universelle, prouve que
cette saisie eut lieu, et montre que nulle part peut-être la destruction ne fut
plus complète et plus systématique.
Mais à Rome, pas plus qu’ailleurs, on ne se contenta de
détruire des livres ou de disperser des archives. L’autorité publique démolit
les sanctuaires chrétiens, et confisqua les vastes propriétés que l’Église
possédait en vertu des donations des fidèles, et qu’elle faisait servir pour la
plupart à la sépulture de ses membres. Si nous avions soit les Actes auxquels
se référèrent plusieurs fois les donatistes dans les controverses postérieures,
soit les lettres officielles données après la persécution pour permettre de recouvrer
les loca ecclesiastica, nous pourrions nous rendre compte de la nature et de l’étendue des biens ravis
aux chrétiens. Malheureusement ces documents ne sont connus que par quelques
allusions, et n’ont été nulle part reproduits intégralement ou même cités avec
détail. Bien rares sont les renseignements que l’on peut glaner ailleurs: comme
ces passages du Livre Pontifical où il est question de la confiscation du
cimetière de Cyriaque, sur la voie Tiburtine, et de
celle d’un domaine de la Sabine «appartenant au nom des chrétiens» et devenu ensuite
«propriété d’Auguste». Si l’on veut comprendre et, pour ainsi dire, toucher du
doigt la crise violente alors subie par le patrimoine ecclésiastique, il faut
descendre aux catacombes.
Quand fut connu l’édit, les chrétiens voulurent
soustraire aux profanations les tombes (fort rares à Rome) qui se trouvaient à
la surface du sol, au-dessus des cimetières souterrains. Telle fut probablement
la pensée d’Aelius Saturninus, époux de la clarissime
Cassin Feretria, car une épitaphe de celle-ci a été
trouvée à fleur de terre, dans l’aire extérieure du cimetière de Calliste, et
une seconde épitaphe toute semblable ferma un humble loculus, dans une
des galeries souterraines antérieures à la paix de l’Église: sans doute les
restes de la noble femme y furent transportés hâtivement, à la première
nouvelle de la persécution. Cependant un tel abri n’offrait encore qu’une
sécurité relative. S’il pouvait protéger dans une certaine mesure les tombes
des simples fidèles, il ne devait point garantir les sépulcres déjà célèbres
des martyrs et des saints contre les insultes des persécuteurs, jaloux d’en
abolir la mémoire. On avait probablement appris déjà à Rome les outrages subis
par les restes des martyrs de Nicomédie, que Dioclétien, après les avoir laissé
d’abord ensevelir honorablement, fit ensuite déterrer et jeter à la mer. Aussi
l’autorité ecclésiastique, en vue du moment prochain où la confiscation
ordonnée par l’édit allait être appliquée aux cimetières, s’empressa-t-elle d’y
mettre, partout où elle le put, les tombes saintes hors de la portée des païens:
elle y réussit parfois si bien que, la persécution finie, les chrétiens eux-mêmes
auront souvent beaucoup de mal à les retrouver.
Un des moyens les plus coûteux, mais aussi les plus sûrs,
consistait à combler de terre les cryptes où reposaient des martyrs illustres:
il parait avoir été employé dans celle des saints Protus et Hyacinthe, sur l’ancienne voie Salaria. Dans le cimetière de Calliste, le pape
Marcellin et son diacre Severus usèrent du même procédé pour rendre
inaccessible aux persécuteurs l’aire de la catacombe où avaient été inhumés les
pontifes du troisième siècle et de nombreux martyrs; environ seize cent
trente-sept mètres cubes de terre furent transportés de loin et à grands frais:
le caveau papal, la chambre funéraire de sainte Cécile, les chambres ornées de
fresques célèbres qui font allusion aux sacrements, les principales galeries de
cette région, furent ainsi enterrés, et demeurèrent en cet état, en partie
jusqu’aux travaux de déblaiement exécutés par le pape Damase, dans la seconde
moitié du quatrième siècle, en partie même jusqu’à nos jours.
Peut-être est-ce après s’être vus déjoués de cette
manière, que les païens voulurent se venger en abattant des édifices construits
dès le troisième siècle au- dessus des principaux cimetières : l’exèdre à trois
absides, servant aux réunions chrétiennes, qui s’élève sur celui de Calliste,
parait avoir été démolie au début de la persécution, pour n’être rebâtie qu’après
la paix de l’Église.
III
Les traditeurs.
La persécution eut toujours une violence particulière
dans l'Afrique romaine, comme si, chez les assaillants et les défenseurs du
christianisme, les âmes y fussent montées à un ton plus élevé qu’ailleurs.
Aussi les cimetières, qui là, ordinairement au moins, n'étaient pas souterrains,
et ne pouvaient être protégés de la même manière que ceux de Rome, durent-ils
voir de lugubres scènes. Quand on connaît le caractère des habitants de cette
ardente province, et qu’on se rappelle les émeutes dirigées à Carthage contre
les tombes chrétiennes dès le temps de Septime Sévère, on se figure
l'acharnement que montrèrent les exécuteurs de la loi de confiscation contre
ses enclos à ciel ouvert, remplis de tombeaux et d'édifices, l'aire des
martyrs, à Cirta, l'aire des sépultures, avec sa chapelle pour les réunions, à
Césarée, l’aire des chrétiens, à Carthage. D'horribles profanations furent
probablement commises dans ces lieux sacrés, qu'à d’autres époques la loi avait
protégés d’une barrière souvent impuissante contre les impatiences de la foule
païenne.
Malheureusement les documents qui nous sont parvenus
racontent seulement la guerre impitoyable faite aux églises et aux livres. La
passion portée dans cette guerre par les païens, la résistance courageuse d’un
grand nombre de pasteurs, de clercs et de laïques, les longs et cruels
reproches, dont fut poursuivie la mémoire de ceux qui avaient eu la faiblesse
de livrer aux persécuteurs les meubles liturgiques et les Bibles, les outrages
prodigués par plusieurs aux hommes modérés qui cherchaient à sauver le saint
dépôt tout en se sauvant eux-mêmes, l’importance enfin que la question des «traditeurs»,
germe du schisme donatiste, garda longtemps en Afrique, nous obligent à donner
une attention particulière aux incidents qui marquèrent la première phase de la
persécution dans cette partie des États de Maximien Hercule.
Sur la lueur des incendies où se consument les murailles
des sanctuaires chrétiens et les manuscrits des Écritures, se détachent
d’abord, avec une singulière netteté, les figures des dépositaires infidèles
qui abandonnèrent aux représentants de l’autorité païenne les trésors
artistiques ou littéraires de leurs Églises. Elles prennent à nos yeux d’autant
plus de relief, qu’avec la fougue naturelle à l’esprit africain quelques-uns de
ces prévaricateurs s’adressèrent ensuite de mutuels reproches et mirent la
postérité dans la confidence de leurs plus pénibles secrets. Nous connaissons
ainsi les fautes de Purpurius, évêque de Limata, homme indigne, déjà soupçonné d’homicide, puis
convaincu d’être traditeur; la faiblesse de Donat, évêque de Maxula, dans la province proconsulaire; celle de Victor,
évêque de Rusicade, en Numidie, qui avait brûlé
lui-même, par ordre du curateur de la cité, un manuscrit des quatre Évangiles,
et prétendait s’excuser en disant que les lettres étaient presque effacées;
celle (si l’on en croit un écrit donatiste) de Fundanus,
évêque d’Abitène: mais au moment où les magistrats
jetaient ses livres dans le feu, une tempête soudaine s’éleva, la pluie tomba,
accompagnée d’éclairs, et le bûcher s’éteignit.
De tous les traditeurs, ceux dont l’histoire est la mieux
connue et, à plusieurs égards, la plus intéressante sont l’évêque et le clergé
de Cirta. Leur chute est attestée par un procès-verbal officiel, précieux
document qui suppléera à la perte de beaucoup d’autres, et permettra de se
faire une idée de la manière dont procédaient les agents municipaux, chargés par
les gouverneurs, sous peine de mort, de faire les perquisitions ordonnées par
l’édit. C’est une scène de persécution, prise sur le vif; c’est en même temps
un regard jeté sur l’intérieur des églises chrétiennes, leur mobilier
liturgique, leurs magasins remplis de vêtements pour les pauvres et de provisions
pour les agapes.
Malgré la longueur de la pièce, je dois la traduire en
entier.
«Dioclétien étant consul pour la huitième fois, et
Maximien pour la septième, le quatorze des calendes de juin, procès-verbal
dressé par Munatius Félix, flamine perpétuel,
curateur de la colonie de Cirta.
Quand on fut arrivé à la maison où s’assemblaient les
chrétiens, Félix, flamine perpétuel, curateur, dit à Paul, évêque: «Apportez
les Écritures de votre loi, et tous les autres écrits que vous avez ici, afin
d’obéir aux ordres des empereurs» Paul, évêque, dit : Ce sont les lecteurs qui ont les Écritures :
ce que nous avons ici, nous vous le donnons.» Félix, flamine perpétuel, curateur,
dit : «Montrez les lecteurs, ou les envoyez chercher.» Paul, évêque, dit : «Vous
les connaissez tous.» Félix, flamine perpétuel, curateur, dit: «Réservant les
lecteurs, que nos officiers produiront, donnez ce que vous avez.» Paul, évêque,
étant assis, entouré de Montan, Victor, Deusatelio, Memorius, prêtres; Mars, flelius et Mars, diacres; Marcuclius, Catulinus,
Silvain et Carosus, sous-diacres; Januarius, Meraclus, Fructuosus, Miggin, Saturninus, Victor, fils de Samsuricus,
et autres, fossoyeurs, Victor, fils d’Aufidius,
rédigea l’inventaire suivant:
«Deux calices d’or, six calices d’argent, six burettes
d’argent, un petit chaudron d’argent, sept lampes d’argent, deux grands
chandeliers, sept petits chandeliers d’airain avec leurs lampes, onze lampes
d'airain avec leurs chaînes, quatre-vingt-deux tuniques de femmes, trente-huit
voiles, seize tuniques d'hommes, treize paires de chaussures d'hommes,
quarante-sept paires de chaussures de femmes, dix-neuf capes de paysan.»
«Félix, flamine perpétuel, curateur, dit à Marcuclius, Silvain et Carosus,
fossoyeurs : «Apportez ce que vous avez.» Silvain et Carosus répondirent : «Tout ce que nous avions ici, nous l'avons jeté dehors.» Félix,
flamine perpétuel, curateur, dit: « Votre réponse sera inscrite au
procès-verbal.»
«On se rendit ensuite à la bibliothèque; mais on en
trouva les armoires vides. Là, Silvain présenta un chapiteau d'argent et une
lampe d’argent, qu'il dit avoir trouvés derrière un grand vase. Victor, fils d'Aufidius, dit à Silvain: «Tu aurais été mis à mort, si tu
ne les avais pas trouvés.» Félix, flamine perpétuel, curateur, dit à Silvain: «Cherche
soigneusement s'il ne reste rien.» Silvain dit: «Il ne reste rien, nous avons
tout mis dehors.» Quand le triclinium eut été ouvert, on y trouva quatre
tonneaux et sept vaisseaux en terre. Félix, flamine perpétuel, curateur, dit:
«Apportez les Écritures que vous possédez, afin d'obéir aux ordres des
empereurs.» Catulinus remit un très gros volume.
Félix, flamine perpétuel, curateur, dit à Marcuclius et à Silvain: «Pourquoi n’avez-vous donné qu’un volume? Apportez les Écritures
que vous possédez.» Catulinus et Marcuclius dirent: «Nous n’en avons pas plus, parce que nous sommes sous-diacres; mais les
lecteurs ont les volumes.» Félix, flamine perpétuel, curateur, dit à Marcuclius et Catulinus: «Montrez-nous
les lecteurs.» Marcuclius et Catulinus diren : «Nous ne savons où ils demeurent.» Félix,
flamine perpétuel, curateur, dit à Catulinus et Marcuclius «Si vous ne savez pas où ils demeurent, donnez
au moins leurs noms.» Catulinus et Marcuclius dirent: «Nous ne sommes pas des traîtres; nous
voilà : fais-nous tuer plutôt.» Félix, flamine perpétuel, curateur, dit: «Qu'on
les arrête.»
«Quand on fut arrivé à la maison d'Eugène, Félix, flamine
perpétuel, curateur, dit à celui-ci: «Donne les Écritures que tu possèdes, afin
de montrer ton obéissance.» Il apporta quatre volumes. Félix, flamine
perpétuel, curateur, dit à Silvain et à Carosus: «Faites
connaître les autres lecteurs.» Silvain et Carosus dirent : «L'évêque vous a déjà déclaré que les greffiers Edusius et Junius les connaissent tous; que ceux-ci vous indiquent leurs maisons.» Les
greffiers Edusius et Junius dirent: «Nous vous les
indiquerons, seigneur.» Et quand on fut à la maison de Félix le marbrier, celui-ci
remit cinq volumes. Quand on fut arrivé à celle de Victorin, il remit huit
volumes. Quand on fut arrivé à celle de Projectus, il
remit cinq gros volumes et deux petits. Et quand on fut arrivé à la maison du
grammairien Victor, Félix, flamine perpétuel, curateur, lui dit: «Donne les
Écritures que tu as, afin de te montrer obéissant.» Le grammairien Victor
offrit deux volumes et quatre cahiers. Félix, flamine perpétuel, curateur, dit
à Victor: «Apporte les Écritures, tu en as davantage.» Le grammairien Victor
dit: «Si j’en avais eu d’autres, je les aurais données.» Quand on fut arrivé à
la maison d’Euticius de Césarée, Félix, flamine
perpétuel, curateur, lui dit: «Obéis, et livre les Écritures que tu possèdes.» Euticius dit: «Je n’en ai pas.» Félix, flamine perpétuel,
curateur, dit: «Ta réponse sera au procès-verbal.» Quand on fut arrivé à la
maison de Codéon, sa femme apporta six volumes.
Félix, flamine perpétuel, curateur, dit: «Cherchez si vous en avez d’autres
encore, et apportez-les.» La femme répondit: «Je n’en ai pas.» Félix, flamine
perpétuel, curateur, dit à Bos, esclave public: «Entre, et cherche si elle en a
davantage.» L’esclave public dit: «J’ai cherché, et n’en ai pas trouvé.» Félix,
flamine perpétuel, curateur, dit à Victorin, Silvain et Carosus : « Si vous n’avez pas fait tout ce que vous deviez, vous en serez responsables»
L’évêque et les clercs de Cirta manquèrent de courage. On
ne saurait cependant lire sans quelque attendrissement cette brève et sèche
relation. Elle montre que, faibles sur un point, ces pauvres chrétiens
s’efforçaient au moins de se retenir sur la pente qui les eût entraînés à une
trahison plus complète. Le concile tenu en 314 dans la ville d’Arles distinguera
trois sortes de traditeurs : ceux qui ont livré les vases sacrés, ceux qui ont
livré les Écritures, ceux qui ont livré les noms des frères. A Cirta, deux de
ces degrés ont été successivement descendus, mais les traditeurs ont trouvé
encore en eux-mêmes assez de force pour refuser d’aller plus loin. Ils avaient
d’abord abandonné le mobilier de l’Église, se flattant de sauver au moins sa
bibliothèque. Par de nouvelles recherches, le curateur a pu cependant arracher
vingt-neuf volumes des mains des lecteurs. Mais les noms de ceux-ci furent
découverts par sa police, ils ne furent pas livrés par leurs frères. «Fais-nous
tuer plutôt, nous ne sommes pas des traîtres» répondirent Catulinus et Marcuclius. On se console en rencontrant ces
restes de courage, d’honneur et de foi au milieu môme de fâcheuses
défaillances.
Cirta n’est pas la seule ville où l’autorité ecclésiastique
ait essayé, avec plus ou moins de succès, de faire «la part du feu» Marin,
évêque d’Aquæ Thibilitanæ,
abandonna aux enquêteurs les archives de son Église, mais sauva les livres
sacrés. Malgré ce résultat heureux, Marin était coupable, et reçut à bon droit
la flétrissante appellation de traditeur. Ce nom ne saurait être
attribué à Bonat, évêque de Calame, qui fit accepter
à la naïveté ou à la complaisance des païens des ouvrages de médecine. L’évêque
de Carthage, Mensurius, s’avisa d’un plus piquant artifice. Il retira de la
basilique tous les livres de religion, qu’il remplaça par des ouvrages
hérétiques : les bibliothèques des grandes Églises conservaient quelquefois, à
titre de renseignements utiles, ces monuments des erreurs de l’esprit humain.
Les agents les prirent, sans demander autre chose. Cependant quelques
décurions, s’apercevant de la méprise, allèrent trouver le proconsul et
dénoncèrent l’évêque. Heureusement, le proconsul ne manquait ni d’esprit ni de
tolérance. Il refusa de faire des perquisitions dans la maison de Mensurius, où
on lui disait que les saints livres étaient cachés. Ainsi fut sauvée la
bibliothèque de l’Église de Carthage: qui sait si nous ne devons pas à
l’habileté de son évêque d’avoir conservé tant d’Actes authentiques des martyrs
africains?
Mensurius représentait le parti prudent et modéré, qui,
fidèle aux enseignements et aux exemples de saint Cyprien, ne s’expose pas
inutilement, ne court pas au-devant du martyre, en fuit même les occasions,
prêt à l’affronter avec courage quand il ne pourra plus être évité. Beaucoup de
prêtres et de laïques imitèrent cette sagesse. Mais, dociles à cet esprit montaniste
que nous retrouvons toujours en Afrique, identique à lui-même malgré les noms
divers sous lesquels il se cache, d’autres, plus emportés ou plus présomptueux,
tinrent à honneur de provoquer les bourreaux. On vit des fidèles devancer les
recherches, déclarer qu’ils gardaient des exemplaires de l’Écriture sainte, et,
mis en demeure de les livrer, encourir un martyre volontaire. Mensurius parle
d’eux avec blâme dans une lettre à Secundus, évêque
de Tigisis. Aussi refusa-t-il de reconnaître de tels
martyrs, se conformant sinon à la lettre, du moins à l'esprit du concile d’Illiberis, qui défendait d’honorer les chrétiens qui
avaient attiré les rigueurs de leurs ennemis en brisant les idoles. D'autres
furent plus compromettants encore. Mensurius cite des gens couverts de crimes
ou perdus de dettes, qui virent avec joie arriver la persécution, et se
dénoncèrent eux-mêmes, soit avec le périlleux espoir de se réhabiliter devant
les hommes ou devant leur propre conscience, soit avec le désir intéressé de
jouir, dans la prison, des aumônes et des dons de toute sorte que la charité
des fidèles y faisait affluer.
La conduite de Mensurius et son jugement sévère sur celle
de quelques exagérés trouvèrent des censeurs, dont les ressentiments donneront
naissance, quelques années plus tard, au schisme donatiste. Pendant que les uns
faisaient courir sur sa conduite et sur celle de son diacre Cécilien d’odieuses
calomnies, d’autres, plus mesurés dans leur blâme sans être peut-être plus
sincères, lui objectaient de fières paroles adressées ailleurs aux agents des
gouverneurs ou des municipalités. C’est ainsi que Secundus,
évêque de Tigisis en Numidie, qui jouera un rôle
considérable à l’origine du schisme, sommé par un centurion et un soldat bénéficiaire
de livrer les manuscrits de son Église, avait répondu: «Je suis chrétien et
évêque, je ne suis pas traditeur». Les militaires se seraient volontiers contentés
d’un semblant d’obéissance: ils le pressèrent de leur abandonner quelques
objets sans valeur. L’évêque refusa, résolu, dit-il, à imiter le martyr juif
Éléazar, qui n’avait pas voulu feindre de manger des viandes défendues, de peur
d’autoriser par son exemple la violation de la loi. C’est Secundus qui raconte lui-même ces faits dans une lettre à Mensurius, avec le désir
visible d’opposer son attitude à celle de son prudent collègue; mais nous
devons ajouter que, quelques années plus tard, au synode de Cirta, après avoir
convaincu de faiblesse plusieurs évêques de sa province, ce prélat si enclin à
faire connaître son courage ne put répondre à la question qu’ils lui posaient :
« Comment, n’ayant point pris la fuite, et étant demeuré longtemps entre les
mains des hommes de la police, as-tu été ensuite renvoyé indemne, si tu n’as
rien livré?». Il est permis de croire que Secundus se
vantait, et de donner la préférence, entre toutes les vertus des temps de
persécution, à la prudence qui évite les chutes et à l’humilité qui voile les
mérites.
Mensurius, heureusement, n’est pas le seul prélat
africain qui ait montré l’exemple de ces vertus. Plus d’un, parmi les chefs des
Églises, trouva le salut dans la fuite; car la tempête, dit saint Optât,
épargna ceux qui se tenaient cachés. De ce nombre était Félix, évêque d’Aptonge, plus tard accusé faussement de tradition par les
donatistes, et réhabilité dans un jugement solennel. Son peuple avait été pris,
à la nouvelle de la persécution, d'une de ces terreurs paniques, non moins
fréquentes et aussi contagieuses que les accès d’héroïsme, dans une province où
se rencontraient sans cesse les extrêmes. Voici en quels termes le païen Affius Cæcilianus, duumvir d’Aptonge, retraçait, onze ans plus tard, les faits qui se
passèrent sous ses yeux. «Ce furent les chrétiens eux-mêmes qui m’envoyèrent
trouver dans le prétoire, me demandant: «Le précepte sacré des empereurs vous
est-il parvenu?» Je répondis: «Non, mais je l’ai déjà vu exécuter à Zama et à
Fumes , où l’on a démoli les basiliques et brûlé les Écritures. Apportez donc
celles que vous avez, afin d’obéir au sacré précepte». Ils envoient alors à la
maison de l’évêque Félix, pour en retirer les Écritures et les livrer au feu
conformément à la loi. Galatius m’accompagna au lieu
où ils avaient auparavant coutume de se rassembler. Là, nous primes la chaire
(épiscopale) et des épitres salutatoires; toutes les
portes furent brûlées, selon l’ordre impérial. Mais les agents que j’avais
envoyés à la maison de l’évêque me répondirent qu’il était absent». Peut-être
Félix, connaissant la faiblesse de ses ouailles, s'était-il enfui afin de leur
épargner la tentation de le livrer lui-même. Mais, avant de partir, il avait eu
soin de déposer entre les mains de chrétiens qu’il croyait plus fermes que les
autres (et qui trahirent sa confiance) les manuscrits précieux de son Église.
Cependant, si belle que soit la prudence et si louable
que soit la retraite, d’autres exemples sont quelquefois nécessaires pour
ranimer les courages et réveiller la foi. La raison n’est persuasive que si de
temps en temps l’enthousiasme vient animer son langage. Après les conseils de
la sagesse, les peuples aiment à goûter la poésie du sacrifice. Celle-ci ne
manqua point à la crise que nous étudions. Il y eut des héros, d’autant plus
vrais et plus touchants qu’ils attendirent le péril au lieu de l’aller
chercher, et n’écoutèrent que la voix du devoir, sans y mêler d’ostentation ou
d’amour-propre.
De ce nombre fut un autre Félix, évêque de Tïbiuca, dans l'Afrique proconsulaire. L'édit ne fut
affiché dans cette ville que le 5 juin. Le jour même, Magnilianus,
curateur de la cité, fît comparaître «les anciens du peuple» chrétien,
c’est-à-dire les membres du clergé. En l’absence de l’évêque, qu'une affaire
avait appelé à Carthage, le prêtre Aper, les lecteurs
Gyrus et Vital, furent amenés devant le magistrat. «Avez-vous les livres divins
?» leur demanda celui-ci. «Nous les avons» répondit Aper.
«Donnez-les, pour qu'ils soient brûlés» commanda le curateur. «Ils sont chez
notre évêque» dit Aper. «Où est-il? Je l’ignore ».
« Vous serez détenus, jusqu’au jour où vous comparaîtrez devant le
proconsul Anulinus». Le lendemain, l’évêque revint de
Carthage. Magnilianus se le fit amener. «Évêque
Félix, dit-il, donne les livres et les papiers que tu possèdes.
— Je les ai, mais je ne les donne pas.
—L’ordre des empereurs doit prévaloir sur tes paroles.
Donne les livres, afin qu’on les brûle.
— Mieux vaut me brûler moi-même que les divines Écritures
: il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes.
—La volonté des empereurs doit être préférée à la tienne.
—La volonté de Dieu doit être préférée à celle des
hommes.
—Réfléchis, dit le magistrat.
Le troisième jour, il fit comparaître de nouveau Félix.
—As-tu réfléchi?
—Ce que j’ai répondu, je le répète, et suis prêt à le
redire devant le proconsul.
—Tu iras donc au proconsul et tu lui rendras raison.
Le décurion Celsinus fut chargé
de le conduire. Mais le voyage ne se fit pas tout de suite, car Félix ne
partit, chargé de chaînes, que le 24 juin : arrivé le même jour dans la
capitale de la province, il fut mis en prison. Le lendemain, dès l’aube, on le
mena devant le proconsul. «Pourquoi ne livres-tu pas tes vaines Écritures?» lui
dit Anulinus. «Je les ai, mais je ne les donnerai pas»
répondit Félix. Le proconsul commanda de l’enfermer dans le cachot souterrain,
réservé aux grands criminels. Après seize jours on l’en tira, tout enchaîné,
pour le conduire de nouveau devant le proconsul : c'était la quatrième heure de
la nuit, environ dix heures du soir. «Pourquoi ne donnes-tu pas tes vaines
Écritures?» demanda encore Anulinus. «Je ne les
donnerai pas,» répondit toujours l’évêque.
Ici se termine la partie véridique de ses Actes; mais
tout n'est probablement pas faux dans les additions légendaires qui y furent
jointes. On a peut-être le droit d'en retenir cette belle et simple prière, prononcée
par lui avant d'être exécuté : «Mon Dieu, je vous rends grâces. Voilà cinquante
ans que je suis en ce monde. J'ai conservé la virginité, j’ai gardé vos Évangiles,
j'ai prêché la foi et la vérité. J'incline devant vous la tête pour être
immolé, ô Seigneur Jésus-Christ, Dieu du ciel et de la terre, Dieu éternel, à
qui soient gloire et magnificence dans les siècles des siècles. Amen». On en
doit retenir aussi cette indication, donnée par un des narrateurs: au moment où
celui-ci écrit, Félix reposait à Carthage, dans le voisinage des célèbres
martyrs de Scillium : in via quae dicitur Scillitanorum. Là fut évidemment son tombeau primitif.
La province proconsulaire n’eut pas seule des martyrs: la
Numidie, témoin de chutes nombreuses, vit aussi de belles victoires dès cette
première phase de la persécution. Bien différents des évêques traditeurs dont
nous avons parlé, ou de cette lèche population d’Aptonge qu’on a vue se ruant à l’apostasie, des laïques numides surent mourir plutôt
que de livrer aux agents du président Florus les Écritures sacrées. «Beaucoup,
arrêtés à cause de leurs refus, souffrirent des maux de toute sorte, affrontèrent
les plus cruels supplices, et furent mis à mort : aussi les honore-t-on à bon
droit comme martyrs, et les loue-t-on de n’avoir pas donné leurs Bibles,
imitant cette femme de Jéricho, qui ne voulut pas livrer à ceux qui les
cherchaient les deux espions juifs, figures de l’Ancien et du Nouveau Testament».
Parmi ces courageux chrétiens on comptait «non seulement des gens de rien, mais
encore des pères de famille» patres familias est ici opposé à infimi, non sans doute pour marquer cette
distinction légale de l’humilior et de l’honestior qui n’avait pas de raison d’être dans la
langue chrétienne, mais pour montrer que plusieurs des laïques martyrisés par Florus eurent le mérite de sacrifier, avec leur vie,
ce qui lui donne surtout du prix en ce monde, les joies de la famille, les
charges honorables de la propriété, les avantages et la dignité d’une haute
situation sociale.
Comme il arriva dans toutes les persécutions, le courage
des martyrs, les excès de leurs ennemis, touchèrent des cœurs généreux. C’est
ainsi qu’Arnobe, païen zélé, parait avoir été amené au christianisme. Il
professait la rhétorique à Sicca, dans la province
proconsulaire, et avait eu Lactance pour élève. De même que beaucoup de
lettrés, Arnobe attaqua souvent la religion du Christ dans ses leçons ou ses
lectures publiques. Cependant, voyant renverser des édifices qui n’avaient
jamais abrité que des réunions innocentes, ou briller des livres remplis de
hautes et pures pensées, il eut un mouvement de révolte. Le sincère penseur
s'indigna de destructions barbares, qui contrastaient avec la tolérance de l'autorité
publique pour des théâtres déshonorés par des fêtes impures, ou pour des poèmes
dans lesquels les bonnes mœurs n'étaient pas moins outragées que les dieux. Il
lui parut que le paganisme, fermant les yeux sur l’impiété vulgaire, avait peur
de la vérité: il se demanda si, quelque jour, on ne détruirait pas aussi les
livres des philosophes, de Cicéron par exemple, coupables d'attaquer par la
raison ce polythéisme croulant de toutes parts, que les chrétiens battaient en
brèche au nom de la révélation. Le spectacle des souffrances de ceux-ci, en
Afrique et en Numidie, acheva ce travail intérieur; un songe ou une vision, dit
saint Jérôme, pressa enfin Arnobe de se soumettre au Christ. C'est alors que,
obligé de rassurer les fidèles de Sicca, qui
l'avaient eu longtemps pour adversaire et voyaient avec défiance venir à eux un
tel prosélyte, le rhéteur converti écrivit ses Disputes contre les païens,
composées, ainsi que l'indique maint passage, parmi les souffrances et les
menaces de la persécution.
LE DEUXIÈME ET LE TROISIÈME ÉDITS (303-304)
|
 |
 |
 |
 |